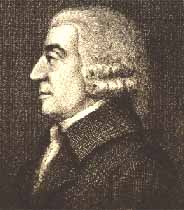Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Adam Smith
| Adam Smith | |||||
| Économiste, philosophe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 1723-1790 | ||||
| Tendance | libéral classique | ||||
| Nationalité | |||||
| Articles internes | Autres articles sur Adam Smith | ||||
| Citation | « Chaque individu en poursuivant son interêt est amené à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions » | ||||
| Interwikis sur Adam Smith | |||||
| |||||
Adam Smith (1723, Kirkcaldy - 17 juillet 1790, Londres) économiste et philosophe d'origine écossaise, participa au développement des Lumières écossaises. Il est considéré, à tort ou à raison, comme le père de l'économie moderne avec son œuvre La Richesse des nations.
Biographie
Sa date de naissance exacte est inconnue, on sait en revanche qu'il fut baptisé le 5 juin 1723 à Kirkcaldy, en Écosse. Il entre à l'Université de Glasgow à 14 ans où il étudie la philosophie morale avec Hutcheson. En 1740, il entre à l'université d'Oxford. De 1748 à 1751, il enseigne la rhétorique et les belles-lettres à Édimbourg.
En 1777 (année suivant la publication de sa Richesse des Nations !), il devient - comme le fut son père - Commissaire des douanes.
Idées
Son œuvre maîtresse The Wealth of Nations (Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations) (parue le 9 mars 1776) a contribué à créer l'économie telle qu'on l'a connaît de nos jours, en en faisant une discipline autonome.
Ce livre présente la doctrine philosophique et économique qui fait du travail la source de la richesse. Cette œuvre est considérée de nos jours, comme la première théorie d'économie politique classique et libérale.
Quand l'essai, qui est un manifeste contre le mercantilisme, paraît en 1776, l'idée de Libre-échange fait son chemin en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Cependant, tout le monde n'est pas convaincu des avantages du libre-échange.
La Richesse des Nations rejette aussi les idées de l'école physiocratique qui voient la terre comme seule source de richesse; au contraire, selon Smith, la richesse ne provient que de la division du travail. Il prône le développement de l'industrie à travers le célèbre exemple de la manufacture d'épingle.
Pour Adam Smith l'économie politique a deux objets :
- procurer au peuple un revenu ou une substance abondante, ou, pour mieux dire, le mettre en état de se procurer lui-même ce revenu et cette substance abondante ;
- fournir à l'État ou à la communauté un revenu suffisant pour le service public.
La maîtrise des principes d'économie politique se propose d'enrichir à la fois le peuple et le souverain.
Le livre eut une influence fondamentale sur la politique économique de l'Angleterre. William Pitt le Jeune appliqua ces principes dans le traité qu'il signa avec la France en 1786, et s'en servit pour l'élaboration de ses budgets. À vrai dire c'était la première fois qu'on appliquait en économie politique les procédés de l'enquête scientifique, ou mieux qu'on tentait d'en faire une science à part entière.
Ce livre relègua les économistes français qui tenaient le haut du pavé dans le monde avec les écoles mercantilistes et les physiocrates. Son auteur fut, avec exagération, considéré comme le « père de l'économie politique ». Pendant près d'un siècle, après avoir fait faire à l'économie politique (l'expression science économique date de la fin du 19e siècle) des progrès indéniables, fut aussi la raison pour laquelle elle stagna et qu'on s'en tint trop longtemps à l'unique conception de la « division du travail ».
La Richesse des nations a été traduite en français par Blavet dès 1779. D'autres bonnes éditions françaises sont celles de Roucher et de la marquise de Condorcet (1790), de Garnier (1802), et l'édition abrégée de Courcelle-Seneuil (1888).
La « main invisible »
La main invisible (expression qui n'apparaît qu'au détour d'une phrase) de la concurrence assure l’intérêt de tous. En d'autres termes, la recherche des intérêts particuliers aboutit à l’intérêt général, à condition de laisser libre court à la concurrence et d’être guidé par la sympathie et les « sentiments moraux ».
Cette idée participe d'un climat intellectuel général, celui des Lumières écossaises. Près de deux siècles plus tard, Friedrich von Hayek reprendra la thématique principale de leurs principaux représentants, Bernard Mandeville, David Hume, Smith et Adam Ferguson, pour asseoir sa théorie de l'ordre spontané, à savoir que les institutions (au sens large du terme) sont "le résultat de l'action des hommes, mais non de l'exécution de leurs desseins".
Voir holisme.
La valeur chez A. Smith
Le prix naturel et le prix de marché. Smith distingue le prix naturel du prix de marché. Le prix réel de chaque chose est l’équivalent de la peine et de l’embarras nécessaire à son acquisition. La valeur relative dépend de la quantité de travail nécessaire à la création du bien. Le prix de marché est le résultat du jeu de la concurrence et s’écarte du prix réel. C’est le fait de la « main invisible ».
Les vertus autorégulatrices du marché
Le jeu de la concurrence permet aux prix de marché de ne pas s’écarter des prix réels durablement. Lorsque les prix de marché sont supérieurs aux prix réels, les producteurs sont rémunérés au-dessus du prix naturel. Cela va attirer d’autres producteurs sur le marché. Avec ces entrées sur le marché, la production va augmenter, l’offre et la demande vont s’équilibrer et le prix de marché va revenir au niveau du prix naturel. A l’inverse, si le prix de marché est inférieur au prix naturel, les producteurs vont quitter le marché, l’offre va diminuer et le marché va se rééquilibrer.
L’apport d’Adam Smith
- distinction fondamentale entre valeur d’usage (utilité) et valeur d’échange (prix).
- la richesse des nations résulte de la spécialisation et de la division du travail.
- thèse de l’échange international. Elaboration de la théorie des avantages absolus : extension de la « main invisible » aux échanges internationaux.
- la doctrine des effets réels (Real Bills Doctrine), théorie de création monétaire reprise par certains économistes autrichiens tels que Antal E. Fekete.
Vision libérale
Adam Smith est considéré par les libéraux comme un auteur mineur. La Richesse des Nations est truffée d’erreurs et de contradictions. C’est Smith qui donnera une grande aura à la valeur-travail, malgré Condillac. Chez Smith, l’entrepreneur est une sorte de zombie, qui n’a aucune influence sur ses concurrents, ses fournisseurs, ses clients. Son entreprise est identique aux autres entreprises. Il ne court aucun risque, jamais. Cet entrepreneur-bureaucrate, comme le dit Philippe Simonnot, est en fait un technicien supérieur tout juste capable d’administrer une entité quelconque.
On réplique : oui, mais Smith a créé le concept majeur de toute la pensée économique libérale, la main invisible. Outre que ce n’est pas l’inventeur de cette idée (on en trouve les prémices dans la "Fable des abeilles" de Bernard Mandeville), mais simplement de la formule, Smith n’y croyait en réalité qu’à moitié. Toutes sortes d’activités ne relèvent pas, chez lui, du laissez-faire : la défense nationale, la navigation au long cours, les ponts, les ports, les routes, la poste, la construction des murs coupe-feu, la conservation des hypothèques, l’exportation de blé, etc. Par ailleurs, Smith continue à prôner un plafonnement à 5% des taux d’intérêt, alors qu’à la même époque ses « confrères » français, Cantillon et Turgot, que pourtant il connaît, plaident pour une déréglementation totale du marché de l’argent. De plus, Smith, s'il en était quelque peu méfiant, n'était pas opposé à l'impôt qu'il jugeait même légitime (« Les sujets d’un État doivent contribuer au soutien du gouvernement »). Enfin, il fit une distinction peu pertinente (inspirée des physiocrates) entre "travail productif" (production de biens matériels) et "travail improductif" (services immatériels). En réalité, la main invisible cache chez Smith la main, bien visible, de l’économiste d’État, au service du Prince bienveillant. Une sorte de souverain-économiste, comme Platon rêvait d'un souverain-philosophe.
Citations
- « Chaque individu ne pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté [...], et ne pense qu'à son propre gain; en cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions; Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société, que s'il avait réellement pour but d'y travailler.» (concept de la « main invisible »)
- « Ce qui est prudence dans la conduite d'un foyer, ne peut être folie dans la conduite d'une grande nation »
- « Tout homme, tant qu'il n'enfreint pas les lois de la justice, demeure en pleine liberté de suivre la route que lui montre son intérêt et de porter où il lui plaît son industrie et son capital, concurremment avec ceux de tout autre homme ou de toute autre classe d'hommes. »
- « L'impôt peut entraver l'industrie du peuple et le détourner de s'adonner à certaines branches de commerce ou de travail »
- « Un impôt inconsidérément établi offre beaucoup d'appât à la fraude »
Œuvres
- 1759, The Theory of Moral Sentiments (La théorie des sentiments moraux),
- 1776, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, London, 3 volumes
- 3ème edition en 1784,
- Nouvelle édition en 1937, Edwin Cannan, Dir., Modern Library Edition. New York: Random House
- 6ème édition en 1950, Edwin Cannan, Dir., London
- Nouvelle édition en 1976, R. H. Campbell et A. S. Skinner, dir., Oxford University Press, Oxford, Vol. 2
- Nouvelle édition en 1981, Roy H. Campbell, Andrew S. Skinner et W. B. Todd, Dir., Indianapolis: Liberty Classics
- Traduction en français
- de 1779 à 1780 par l'abbé Jean-Louis Blavet, "Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Journal de l'agriculture, des arts et du commerce
- en 1786 par Blavet, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 6 volumes
- en 1800 par Blavet, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 3 volumes
- en 1802 ou 1804 ?, par Germain Garnier, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 2 volumes
- en 1843, par le comte Germain Garnier, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, notice biographique d’Adolphe Blanqui, Guillaumin, Paris, 2 volumes.
- en 1881, par le comte Germain Garnier, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, notes biographique d’Adolphe Blanqui et Jean-Baptiste Say, Guillaumin, Paris, 2 volumes
- en 1996, par Paulette Taïeb, "Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations", Presses Universitaires de France, Paris, 4 volumes
- 1795, ‘The Principles Which Lead and Direct Philosophical Enquiries: Illustrated by the History of Astronomy’
- 1896, Lectures on Jurisprudence
Annexes
Articles connexes
| Smith, Main Invisible, Simonnot et l'Huma. (for) | |
Liens externes
En français
- (fr)Textes et analyses sur Catallaxia.
- (fr)Pourquoi lire Adam Smith aujourd'hui ?, par Ludwig von Mises
En anglais
- (en)The Adam Smith Myth par Murray Rothbard.
| Accédez d'un seul coup d’œil au portail sur l'histoire du libéralisme et de la liberté. |
| Accédez d'un seul coup d’œil au portail des grands auteurs et penseurs du libéralisme. |
| Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie. |