Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Différences entre les versions de « Ronald Coase »
(→Textes) |
|||
| (278 versions intermédiaires par 10 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox individu | {{Infobox individu | ||
| identité =Ronald Coase | | identité =Ronald Coase | ||
| type = [[: | | type = [[:Catégorie:Économistes|économiste]] | ||
| dates = | | dates = ([[1910]]-[[2013]]) | ||
| image =[[Image:Coasephoto.jpg|Ronald Coase (copyright Coase Institute (http://coase.org))]] | | image = [[Image:Coasephoto.jpg|Ronald Coase (copyright Coase Institute (http://coase.org))]] | ||
| tendance = [[analyse économique des institutions]] | | tendance = [[analyse économique des institutions]] | ||
| nationalité = {{Royaume-Uni}} | |||
| citation = | | citation = | ||
| Catallaxia = | | Catallaxia = | ||
| Librairal = | | Librairal = | ||
}} | }} | ||
'''Ronald Coase''', né le [[29 décembre]] [[1910]] et décédé le [[1er septembre]] [[2013]] fut un économiste britannique, considéré comme le père fondateur de la théorie des [[coûts de transaction]] (sous-branche de la nouvelle économie institutionnelle) et lauréat du [[Prix Nobel d'Économie]] en [[1991]]. Il fait partie des économistes qui ont fait naître l'[[analyse économique des institutions]], l'[[analyse économique du droit]] et le courant [[néo-institutionnalisme|néo-institutionnelle]]. Précurseur, ses idées théoriques ont permis de faire évoluer les droits de propriété sur la [[bande de fréquence]] (radio, télévision, téléphonie). | |||
'''Ronald Coase''' | |||
== Coûts de transaction == | == Coûts de transaction == | ||
Dans son célèbre article ''The nature of the firm'' ([[1937]]), '''Ronald Coase''' s'attache à répondre à la question suivante : ''Pourquoi émergent dans l'océan de la coopération inconsciente des îlots de pouvoir conscient ?'' Autrement dit, il pose cette question métaphysique, pourquoi toutes les transactions ne passent pas par le marché mais qu'elles nécessitent l'existence d'organisations comme l'[[entreprise]] ? Selon Ronald Coase, le recours au [[marché]] a un coût (remettant en cause l'hypothèse néoclassique d'information parfaite) et les entreprises existent pour réduire ces coûts. Cette analyse est exemplaire de l'[[épistémologie]] [[réalisme|réaliste]] de Ronald Coase. Ceci fut révolutionnaire. | |||
Les coûts de l'utilisation du mécanisme des prix ressortent de trois grandes catégories : | |||
# Les coûts de découvertes des prix adéquats qui ne sont pas totalement éliminés par les intermédiaires. Quand on parle de coûts, il ne s’agit pas seulement des coûts de vente, mais aussi des coûts de transaction, qui sont tous ceux occasionnés par la recherche d’un partenaire sur le marché | |||
# Les coûts de négocier et de conclure un [[contrat]] séparé pour chaque échange. Par exemple, au lieu de négocier chaque jour l’embauche de main d’œuvre, l'entreprise a des salariés sous [[contrat]] qui doivent obéir aux ordres qui leur sont donnés. | |||
# Les coûts de coordination quand les tâches sont incertaines | |||
Les entreprises réduisent les coûts de transaction en substituant l’ordre hiérarchique à la [[L'Offre et la demande (loi de)|loi de l’offre et de la demande]]. L'analyse de Ronald Coase a des implications sur l'explication de la structure formelle et informelle de l'organisation. Car, bien évidemment, l’organisation hiérarchique a ses propres défauts et l’on voit souvent la firme recourir à des processus inverses de désintégration pour retrouver de la compétitivité grâce à l’aiguillon de la [[concurrence]]. | |||
Coase souligne par ailleurs l’importance de l’information. Elle se paie. Elle accapare des ressources. Il arrive un moment où la quête d’information coûte plus cher qu’elle ne rapporte. | Coase souligne par ailleurs l’importance de l’information. Elle se paie. Elle accapare des ressources. Il arrive un moment où la quête d’information coûte plus cher qu’elle ne rapporte. À ce moment-là, il vaut mieux renoncer. Mais cela ne signifie pas que le comportement est irrationnel, bien au contraire. J’accepte mon ignorance relative, en connaissance de cause. Le coût de l’information est une donnée fondamentale, l’œuf de Colomb de Coase. Car, si l’information était gratuite et parfaite, elle serait disponible partout et toute incertitude aurait disparu. Ce faisant, les entreprises n’auraient plus lieu d’être et la planification centralisée serait possible. Donc, l'entreprise ne peut grossir de façon illimitée. Il existe des frontières entre elle-même et le marché. Une entreprise tend à s'accroître jusqu'au point où les coûts pour organiser une transaction supplémentaire à l'intérieur de l'entreprise deviennent égaux aux coûts pour réaliser la même transaction au moyen de l'échange sur le marché, ou par les coûts d'organisation dans une autre entreprise. | ||
Les institutions ne tombent donc pas du ciel, elles sont produites par l’[[économie]] ou répondent à des nécessités économiques. Car en effet, aux côtés des coûts de transaction du marché (confiance en la robe d’un avocat, négociation et application des [[contrat]]s), il | Les institutions ne tombent donc pas du ciel, elles sont produites par l’[[économie]] ou répondent à des nécessités économiques. Car en effet, aux côtés des coûts de transaction du marché (confiance en la robe d’un avocat, négociation et application des [[contrat]]s), il existe des coûts de transaction managériaux (établissement, maintien ou changement de l’organisation de l’entreprise, fonctionnement, etc) et aussi des coûts de transaction [[politique]] (liés au maintien ou au changement de l’entité politique, au fonctionnement de celle-ci également, c’est-à-dire les dépenses courantes des fonctions régaliennes de l’[[État]]). | ||
== Théorème de Coase == | == Théorème de Coase == | ||
{{citation bloc | Si les coûts de transaction sont nuls, les agents concernés par un [[externalité|effet externe]] négocieront spontanément une solution qui rétablit une allocation des ressources [[optimum de Pareto|Pareto-optimale]] et cela, quelle que soit la définition des droits de propriété.|Théorème de Coase}} | |||
Avec Coase, se pose la question de la définition et du coût des droits de [[propriété]]. Jusqu’alors, on appliquait aveuglément le principe pollueur-payeur de [[Arthur Cecil Pigou|Pigou]]. Le « coût social » d’une [[pollution]] étant supérieur au « coût privé » pour l’entreprise, il faut donc taxer (ou subventionner dans le cas inverse). L’intervention de l'État est donc toujours de mise. | |||
Or on sait bien à présent que l’[[État]] ne peut pas ne pas substituer ses propres préférences à celles des particuliers. Et bien sûr, parler des « préférences de l'État » ne veut rien dire (voir aussi le [[Kenneth_Arrow#Le théorème d'Arrow|théorème d'Arrow]]). C’est une expression qui anthropomorphise l'État. L'État, en lui-même, ne peut avoir de préférence. Les hommes qui composent cet État, eux seuls, peuvent en avoir. Ce que Coase montre, c’est que le principe établi par Pigou repose sur un modèle néo-classique où il n'existe pas de coût de transaction. Dans ce cas, et uniquement, dans ce cas, il est plus efficient de laisser pollué et pollueur négocier entre eux. Et peu importe quelle est la répartition initiale des droits de [[propriété]], que la propriété soit celle d'une partie, le pollueur, ou appartenant au pollué. Par exemple, si une usine a un droit de propriété sur l’air environnant, qui lui permette de polluer librement, les propriétaires du camping voisin vont le transformer en champ de carottes. Si tous, et donc y compris les propriétaires dudit camping, ont un droit sur l’air environnant, qu’ils peuvent vouloir pollué ou non pollué, ils vont s’entendre avec l’usine pour qu’elle leur achète leur droit, de telle sorte qu’elle puisse continuer à polluer comme bon lui semble. Quelle que soit l’attribution au départ des droits, si on laisse les parties négocier librement, la solution choisie est la même et elle est efficiente. Les [[droit]]s se déplacent vers ceux pour qui ils ont la plus grande valeur et ce déplacement est efficient. | |||
Mais il faut pour cela que les coûts de transaction soient nuls. S’ils ne le sont pas, les négociations entre les propriétaires du camping et l’usine peuvent être longues et difficiles. C’est dans ce cas qu’une intervention extérieure est nécessaire. Les institutions existent non pas seulement pour réduire les coûts de transaction ; elles existent parce que les coûts de transaction ne sont pas nuls. Et, Ronald Coase veut démontrer qu'il existe sur le marché de nombreux cas où des entrepreneurs exercent leur talent, effectivement pour faciliter l'internalisation des coûts de transaction (par exemple, les agents immobiliers ou les assureurs). Ceci signifie que l'institution "État" n'est pas nécessairement obligatoire pour régler tous les cas de figure d'existence des coûts de transaction. L'existence même de l'entrepreneur est due à la présence des coûts de transaction. Ceci se vérifie tous les jours dans les activités de négoce. Si l’État est désigné comme le seul capable d'agir dans ce principe, il empêche l'émergence de solutions par des individus et, donc, conduit à la faillite du marché. | |||
De façon opportuniste, le théorème de Coase fut un formidable défi aux juristes utilitaristes et le détournant de sa signification première en l'appuyant sur le critère d'efficience. Or, la [[impôt|taxation]] et la réglementation éloignent et bloquent l’efficience du marché<ref>Si, en s’équipant en filtres, une usine échappe à la taxe, la solution n’est pas efficiente : l’efficience, c’est la pollution. Car le coût des filtres est plus élevé que le coût de la transformation du camping en champ de carottes.</ref>. Si la [[propriété]] peut être définie comme le droit d’exclure autrui d’un bien, alors elle a un caractère absolu, précisent-ils. Ce qui signifie qu’autrui ne peut empiéter sur ma propriété en faisant appel à l’[[intérêt général]], ou à quoi que ce soit. Le fait que le droit de propriété ne peut être déduit ou transféré que par le consentement du propriétaire en fait un droit absolu. | |||
[[Richard Posner|Posner]] ajoute que l’efficience justifie le caractère absolu du droit de propriété, dans le cas où les coûts de transaction sont faibles. S’ils sont élevés, la reconnaissance de droits absolus est inefficiente. Par exemple, je ne puis avoir un droit de propriété absolu sur les ondes, car je ne puis empêcher celles-ci de pénétrer dans ma maison. Des mécanismes alternatifs doivent être mis en place : règles de [[responsabilité]], instauration d’un domaine éminent, ''zoning''. Autrement dit, dès que les coûts de transaction empêchent les droits de propriété d’être achetés sur le [[marché]] par ceux qui les valorisent le plus, ces droits doivent être définis à l’avance le mieux possible de manière autoritaire ; ensuite, on laisse jouer le mécanisme des responsabilités et/ou on réglemente. | [[Richard Posner|Posner]] ajoute que l’efficience justifie le caractère absolu du droit de propriété, dans le cas où les coûts de transaction sont faibles. S’ils sont élevés, la reconnaissance de droits absolus est inefficiente. Par exemple, je ne puis avoir un droit de propriété absolu sur les ondes, car je ne puis empêcher celles-ci de pénétrer dans ma maison. Des mécanismes alternatifs doivent être mis en place : règles de [[responsabilité]], instauration d’un domaine éminent, ''[[zoning]]''. Autrement dit, dès que les coûts de transaction empêchent les droits de propriété d’être achetés sur le [[marché]] par ceux qui les valorisent le plus, ces droits doivent être définis à l’avance le mieux possible de manière autoritaire ; ensuite, on laisse jouer le mécanisme des responsabilités et/ou on réglemente. | ||
Les théoriciens de l' | Les théoriciens de l'[[École autrichienne]] contestent le théorème de Coase en raison de la [[subjectivité de la valeur]] et le considèrent plutôt comme un principe [[utilitarisme|utilitariste]] : | ||
{{citation bloc | Aussi longtemps que les valeurs de part et d'autre sont réelles ou générales, le théorème de Coase est correct. Cependant, si ces valeurs sont psychologiques ou ne sont pas partagées par tous, il est incorrect. |[[Walter Block]], ''Ethics, Efficiency, Coasian Property Rights, and Psychic Income: A Reply to Harold Demsetz'', Review of Austrian Economics, 8, 1995, 64, [http://mises.org/journals/rae/pdf/rae8_2_4.pdf]}} | |||
En effet, Coase laisse de côté (comme la plupart des autres économistes) l'impossibilité de conduire des comparaisons interpersonnelles de l'utilité subjective. En outre, il oublie que les coûts de transactions ne sont jamais nuls. Pour cette raison, [[Gary North]] écrit en plaisantant que le théorème de Coase est un exemple d'externalité : bénéfices privés pour Coase et coûts pour ceux qui adoptent son approche<ref>[[Gary North]], [http://www.garynorth.com/freebooks/docs/pdf/the_coase_theorem.pdf The Coase Theorem], 1992.</ref>. [[Hans-Hermann Hoppe]] (''La Grande Fiction - l'État, cet imposteur'') condamne l'approche de Coase comme contraire à l'éthique de la propriété privée, car relevant d'une "éthique de maximisation de la richesse globale" qui s'affranchit de toute notion de justice, et qui n'est par ailleurs pas cohérente puisqu'il est impossible de savoir ''ex ante'' si une action aboutit à maximiser la richesse globale. | |||
'' | Mais, il serait temps maintenant de discuter du véritable message de Ronald Coase, au lieu d'inverser ses critiques d'un système pareto-optimal : | ||
{{citation bloc | Et le débat se poursuit, 47 ans après la publication du "problème du coût social" (Coase, 1960), l'essai est reconnu comme la source des idées en question. Il n'y a qu'un seul problème : Ronald Coase soutient que le théorème qui porte son nom transmet une idée qui est l'antithèse du message qu'il avait l'intention de donner. Mon point de vue est que pratiquement toutes les critiques du théorème de Coase ne parviennent pas à apprécier le message réel que Coase destinait aux « coûts sociaux » et elles sont donc, pour l'essentiel hors de propos. Tragiquement, parce que nous nous sommes concentrés sur ce qu'il ne disait pas, nous n'avons pas compris ce qu'il disait. Par conséquent, nous n'avons pas suffisamment apprécié ni nous n'avons suffisamment critiqué son message réel.|[[Glenn Fox]], [[2007]], p273<ref>"And the debating continues, 47 years after the publication of “The Problem of Social Cost” (Coase 1960), the essay recognized as the source of the ideas in question. There is only one problem: Ronald Coase maintains that the theorem that bears his name conveys an idea that is antithetical to the message that he intended. My view is that virtually all of the criticism of the Coase theorem fails to appreciate the actual message that Coase intended with “Social Cost” and is, therefore, essentially irrelevant. Tragically, because we have focused on what he was not saying, we have not grasped what he was saying. Consequently we have been neither sufficiently appreciative nor sufficiently critical of his actual message." [[Glenn Fox]], [[2007]], p273</ref>}} | |||
== | == Notes et références == | ||
{{références | colonnes = 2}} | |||
== Publications == | |||
:Pour une liste détaillée des œuvres de Ronald Coase, voir [[Ronald Coase (bibliographie)]] | |||
== Littérature secondaire == | |||
Pour voir les publications qui ont un lien d'étude, d'analyse ou de recherche avec les travaux et la pensée de l'auteur : [[Ronald Coase (littérature secondaire)]] | |||
==Voir aussi== | |||
* [[Coûts de transaction]] | |||
== | |||
* [[ | |||
* | ==Citations sur Ronald Coase== | ||
* Coase était un économiste remarquable, au sens où c'était un esprit indépendant, rigoureux, créatif, avec des idées applicables qui nous expliquent le monde qui nous entoure — un véritable penseur, en d'autres termes. Extrêmement rigoureux, il est connu pour avoir élaboré un théorème éponyme (sur la façon dont les marchés excellent à répartir les ressources et les nuisances comme la pollution), postulat qu'il a énoncé sans un seul mot de mathématiques, mais qui est aussi fondamental que bien des choses qui ont été écrites dans cette discipline. Outre son « théorème », Coase a été le premier à expliquer pourquoi les entreprises existent. ([[Nassim Nicholas Taleb]], ''Jouer sa peau: Asymétries cachées dans la vie quotidienne'') | |||
== Liens externes == | |||
*{{fr}}{{pdf}}[http://www.eyrolles.com/Chapitres/9782708120006/Chap1_Coase.pdf L’entreprise, le marché et le droit] Éditions d’Organisation, 2005, extrait Chapitre 1 : L'entreprise, le marché et le droit | |||
== Textes == | |||
* {{fr}}[https://www.contrepoints.org/2013/09/04/137687-ronald-coase-prix-nobel-economie Présentation de Ronald Coase], [[Emmanuel Martin]] | |||
* {{fr}}[https://www.contrepoints.org/2017/01/21/278415-ronald-coase-a-apporte-a-leconomie Ce que Ronald Coase a apporté à l’économie], article [[Contrepoints]] | |||
* {{fr}}[http://blog.georgeslane.fr/post/2005/08/22/45-ronald-h-coase-prix-nobel-de-sciences-economiques-1991 Ronald H. Coase, prix Nobel de sciences économiques 1991] par [[Georges Lane]] | |||
* {{fr}}[https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2002-2-page-111.htm Le « théorème de Coase », une réflexion sur les fondements microéconomiques de l’intervention publique], Bertrand, É. & Destais, C. (2002) | |||
* {{en}}[http://www.lib.uwo.ca/programs/generalbusiness/coase.html RONALD H. COASE (1910 - )] Notes biographiques et bibliographiques de la Bud Johnston Library | |||
== Archives audio == | |||
* | * [http://files.libertyfund.org/files/979/CoaseMP3.mp3 The Intellectual Portrait Series: A Conversation with Ronald H. Coase], Interview de Ronald H. Coase par [[Richard Epstein]], en [[2002]], Indianapolis: Liberty Fund, partie de "The Intellectual Portrait Series: Conversations with Leading Classical Liberal Figures of Our Time" | ||
{{Portail économie}} | |||
{{ | {{DEFAULTSORT:Coase, Ronald}} | ||
[[Catégorie:XXe siècle]] | |||
[[ | [[Catégorie:Économistes]] | ||
Version actuelle datée du 31 janvier 2024 à 22:02
| Ronald Coase | |||||
| économiste | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | (1910-2013) | ||||
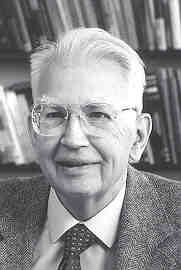
| |||||
| Tendance | analyse économique des institutions | ||||
| Nationalité | |||||
| Articles internes | Autres articles sur Ronald Coase | ||||
| Citation | |||||
| Interwikis sur Ronald Coase | |||||
Ronald Coase, né le 29 décembre 1910 et décédé le 1er septembre 2013 fut un économiste britannique, considéré comme le père fondateur de la théorie des coûts de transaction (sous-branche de la nouvelle économie institutionnelle) et lauréat du Prix Nobel d'Économie en 1991. Il fait partie des économistes qui ont fait naître l'analyse économique des institutions, l'analyse économique du droit et le courant néo-institutionnelle. Précurseur, ses idées théoriques ont permis de faire évoluer les droits de propriété sur la bande de fréquence (radio, télévision, téléphonie).
Coûts de transaction
Dans son célèbre article The nature of the firm (1937), Ronald Coase s'attache à répondre à la question suivante : Pourquoi émergent dans l'océan de la coopération inconsciente des îlots de pouvoir conscient ? Autrement dit, il pose cette question métaphysique, pourquoi toutes les transactions ne passent pas par le marché mais qu'elles nécessitent l'existence d'organisations comme l'entreprise ? Selon Ronald Coase, le recours au marché a un coût (remettant en cause l'hypothèse néoclassique d'information parfaite) et les entreprises existent pour réduire ces coûts. Cette analyse est exemplaire de l'épistémologie réaliste de Ronald Coase. Ceci fut révolutionnaire.
Les coûts de l'utilisation du mécanisme des prix ressortent de trois grandes catégories :
- Les coûts de découvertes des prix adéquats qui ne sont pas totalement éliminés par les intermédiaires. Quand on parle de coûts, il ne s’agit pas seulement des coûts de vente, mais aussi des coûts de transaction, qui sont tous ceux occasionnés par la recherche d’un partenaire sur le marché
- Les coûts de négocier et de conclure un contrat séparé pour chaque échange. Par exemple, au lieu de négocier chaque jour l’embauche de main d’œuvre, l'entreprise a des salariés sous contrat qui doivent obéir aux ordres qui leur sont donnés.
- Les coûts de coordination quand les tâches sont incertaines
Les entreprises réduisent les coûts de transaction en substituant l’ordre hiérarchique à la loi de l’offre et de la demande. L'analyse de Ronald Coase a des implications sur l'explication de la structure formelle et informelle de l'organisation. Car, bien évidemment, l’organisation hiérarchique a ses propres défauts et l’on voit souvent la firme recourir à des processus inverses de désintégration pour retrouver de la compétitivité grâce à l’aiguillon de la concurrence.
Coase souligne par ailleurs l’importance de l’information. Elle se paie. Elle accapare des ressources. Il arrive un moment où la quête d’information coûte plus cher qu’elle ne rapporte. À ce moment-là, il vaut mieux renoncer. Mais cela ne signifie pas que le comportement est irrationnel, bien au contraire. J’accepte mon ignorance relative, en connaissance de cause. Le coût de l’information est une donnée fondamentale, l’œuf de Colomb de Coase. Car, si l’information était gratuite et parfaite, elle serait disponible partout et toute incertitude aurait disparu. Ce faisant, les entreprises n’auraient plus lieu d’être et la planification centralisée serait possible. Donc, l'entreprise ne peut grossir de façon illimitée. Il existe des frontières entre elle-même et le marché. Une entreprise tend à s'accroître jusqu'au point où les coûts pour organiser une transaction supplémentaire à l'intérieur de l'entreprise deviennent égaux aux coûts pour réaliser la même transaction au moyen de l'échange sur le marché, ou par les coûts d'organisation dans une autre entreprise.
Les institutions ne tombent donc pas du ciel, elles sont produites par l’économie ou répondent à des nécessités économiques. Car en effet, aux côtés des coûts de transaction du marché (confiance en la robe d’un avocat, négociation et application des contrats), il existe des coûts de transaction managériaux (établissement, maintien ou changement de l’organisation de l’entreprise, fonctionnement, etc) et aussi des coûts de transaction politique (liés au maintien ou au changement de l’entité politique, au fonctionnement de celle-ci également, c’est-à-dire les dépenses courantes des fonctions régaliennes de l’État).
Théorème de Coase
« Si les coûts de transaction sont nuls, les agents concernés par un effet externe négocieront spontanément une solution qui rétablit une allocation des ressources Pareto-optimale et cela, quelle que soit la définition des droits de propriété. »
— Théorème de Coase
Avec Coase, se pose la question de la définition et du coût des droits de propriété. Jusqu’alors, on appliquait aveuglément le principe pollueur-payeur de Pigou. Le « coût social » d’une pollution étant supérieur au « coût privé » pour l’entreprise, il faut donc taxer (ou subventionner dans le cas inverse). L’intervention de l'État est donc toujours de mise.
Or on sait bien à présent que l’État ne peut pas ne pas substituer ses propres préférences à celles des particuliers. Et bien sûr, parler des « préférences de l'État » ne veut rien dire (voir aussi le théorème d'Arrow). C’est une expression qui anthropomorphise l'État. L'État, en lui-même, ne peut avoir de préférence. Les hommes qui composent cet État, eux seuls, peuvent en avoir. Ce que Coase montre, c’est que le principe établi par Pigou repose sur un modèle néo-classique où il n'existe pas de coût de transaction. Dans ce cas, et uniquement, dans ce cas, il est plus efficient de laisser pollué et pollueur négocier entre eux. Et peu importe quelle est la répartition initiale des droits de propriété, que la propriété soit celle d'une partie, le pollueur, ou appartenant au pollué. Par exemple, si une usine a un droit de propriété sur l’air environnant, qui lui permette de polluer librement, les propriétaires du camping voisin vont le transformer en champ de carottes. Si tous, et donc y compris les propriétaires dudit camping, ont un droit sur l’air environnant, qu’ils peuvent vouloir pollué ou non pollué, ils vont s’entendre avec l’usine pour qu’elle leur achète leur droit, de telle sorte qu’elle puisse continuer à polluer comme bon lui semble. Quelle que soit l’attribution au départ des droits, si on laisse les parties négocier librement, la solution choisie est la même et elle est efficiente. Les droits se déplacent vers ceux pour qui ils ont la plus grande valeur et ce déplacement est efficient.
Mais il faut pour cela que les coûts de transaction soient nuls. S’ils ne le sont pas, les négociations entre les propriétaires du camping et l’usine peuvent être longues et difficiles. C’est dans ce cas qu’une intervention extérieure est nécessaire. Les institutions existent non pas seulement pour réduire les coûts de transaction ; elles existent parce que les coûts de transaction ne sont pas nuls. Et, Ronald Coase veut démontrer qu'il existe sur le marché de nombreux cas où des entrepreneurs exercent leur talent, effectivement pour faciliter l'internalisation des coûts de transaction (par exemple, les agents immobiliers ou les assureurs). Ceci signifie que l'institution "État" n'est pas nécessairement obligatoire pour régler tous les cas de figure d'existence des coûts de transaction. L'existence même de l'entrepreneur est due à la présence des coûts de transaction. Ceci se vérifie tous les jours dans les activités de négoce. Si l’État est désigné comme le seul capable d'agir dans ce principe, il empêche l'émergence de solutions par des individus et, donc, conduit à la faillite du marché.
De façon opportuniste, le théorème de Coase fut un formidable défi aux juristes utilitaristes et le détournant de sa signification première en l'appuyant sur le critère d'efficience. Or, la taxation et la réglementation éloignent et bloquent l’efficience du marché[1]. Si la propriété peut être définie comme le droit d’exclure autrui d’un bien, alors elle a un caractère absolu, précisent-ils. Ce qui signifie qu’autrui ne peut empiéter sur ma propriété en faisant appel à l’intérêt général, ou à quoi que ce soit. Le fait que le droit de propriété ne peut être déduit ou transféré que par le consentement du propriétaire en fait un droit absolu.
Posner ajoute que l’efficience justifie le caractère absolu du droit de propriété, dans le cas où les coûts de transaction sont faibles. S’ils sont élevés, la reconnaissance de droits absolus est inefficiente. Par exemple, je ne puis avoir un droit de propriété absolu sur les ondes, car je ne puis empêcher celles-ci de pénétrer dans ma maison. Des mécanismes alternatifs doivent être mis en place : règles de responsabilité, instauration d’un domaine éminent, zoning. Autrement dit, dès que les coûts de transaction empêchent les droits de propriété d’être achetés sur le marché par ceux qui les valorisent le plus, ces droits doivent être définis à l’avance le mieux possible de manière autoritaire ; ensuite, on laisse jouer le mécanisme des responsabilités et/ou on réglemente.
Les théoriciens de l'École autrichienne contestent le théorème de Coase en raison de la subjectivité de la valeur et le considèrent plutôt comme un principe utilitariste :
« Aussi longtemps que les valeurs de part et d'autre sont réelles ou générales, le théorème de Coase est correct. Cependant, si ces valeurs sont psychologiques ou ne sont pas partagées par tous, il est incorrect. »
— Walter Block, Ethics, Efficiency, Coasian Property Rights, and Psychic Income: A Reply to Harold Demsetz, Review of Austrian Economics, 8, 1995, 64, [1]
En effet, Coase laisse de côté (comme la plupart des autres économistes) l'impossibilité de conduire des comparaisons interpersonnelles de l'utilité subjective. En outre, il oublie que les coûts de transactions ne sont jamais nuls. Pour cette raison, Gary North écrit en plaisantant que le théorème de Coase est un exemple d'externalité : bénéfices privés pour Coase et coûts pour ceux qui adoptent son approche[2]. Hans-Hermann Hoppe (La Grande Fiction - l'État, cet imposteur) condamne l'approche de Coase comme contraire à l'éthique de la propriété privée, car relevant d'une "éthique de maximisation de la richesse globale" qui s'affranchit de toute notion de justice, et qui n'est par ailleurs pas cohérente puisqu'il est impossible de savoir ex ante si une action aboutit à maximiser la richesse globale.
Mais, il serait temps maintenant de discuter du véritable message de Ronald Coase, au lieu d'inverser ses critiques d'un système pareto-optimal :
« Et le débat se poursuit, 47 ans après la publication du "problème du coût social" (Coase, 1960), l'essai est reconnu comme la source des idées en question. Il n'y a qu'un seul problème : Ronald Coase soutient que le théorème qui porte son nom transmet une idée qui est l'antithèse du message qu'il avait l'intention de donner. Mon point de vue est que pratiquement toutes les critiques du théorème de Coase ne parviennent pas à apprécier le message réel que Coase destinait aux « coûts sociaux » et elles sont donc, pour l'essentiel hors de propos. Tragiquement, parce que nous nous sommes concentrés sur ce qu'il ne disait pas, nous n'avons pas compris ce qu'il disait. Par conséquent, nous n'avons pas suffisamment apprécié ni nous n'avons suffisamment critiqué son message réel. »
— Glenn Fox, 2007, p273[3]
Notes et références
- ↑ Si, en s’équipant en filtres, une usine échappe à la taxe, la solution n’est pas efficiente : l’efficience, c’est la pollution. Car le coût des filtres est plus élevé que le coût de la transformation du camping en champ de carottes.
- ↑ Gary North, The Coase Theorem, 1992.
- ↑ "And the debating continues, 47 years after the publication of “The Problem of Social Cost” (Coase 1960), the essay recognized as the source of the ideas in question. There is only one problem: Ronald Coase maintains that the theorem that bears his name conveys an idea that is antithetical to the message that he intended. My view is that virtually all of the criticism of the Coase theorem fails to appreciate the actual message that Coase intended with “Social Cost” and is, therefore, essentially irrelevant. Tragically, because we have focused on what he was not saying, we have not grasped what he was saying. Consequently we have been neither sufficiently appreciative nor sufficiently critical of his actual message." Glenn Fox, 2007, p273
Publications
- Pour une liste détaillée des œuvres de Ronald Coase, voir Ronald Coase (bibliographie)
Littérature secondaire
Pour voir les publications qui ont un lien d'étude, d'analyse ou de recherche avec les travaux et la pensée de l'auteur : Ronald Coase (littérature secondaire)
Voir aussi
Citations sur Ronald Coase
- Coase était un économiste remarquable, au sens où c'était un esprit indépendant, rigoureux, créatif, avec des idées applicables qui nous expliquent le monde qui nous entoure — un véritable penseur, en d'autres termes. Extrêmement rigoureux, il est connu pour avoir élaboré un théorème éponyme (sur la façon dont les marchés excellent à répartir les ressources et les nuisances comme la pollution), postulat qu'il a énoncé sans un seul mot de mathématiques, mais qui est aussi fondamental que bien des choses qui ont été écrites dans cette discipline. Outre son « théorème », Coase a été le premier à expliquer pourquoi les entreprises existent. (Nassim Nicholas Taleb, Jouer sa peau: Asymétries cachées dans la vie quotidienne)
Liens externes
- (fr)
 [pdf]L’entreprise, le marché et le droit Éditions d’Organisation, 2005, extrait Chapitre 1 : L'entreprise, le marché et le droit
[pdf]L’entreprise, le marché et le droit Éditions d’Organisation, 2005, extrait Chapitre 1 : L'entreprise, le marché et le droit
Textes
- (fr)Présentation de Ronald Coase, Emmanuel Martin
- (fr)Ce que Ronald Coase a apporté à l’économie, article Contrepoints
- (fr)Ronald H. Coase, prix Nobel de sciences économiques 1991 par Georges Lane
- (fr)Le « théorème de Coase », une réflexion sur les fondements microéconomiques de l’intervention publique, Bertrand, É. & Destais, C. (2002)
- (en)RONALD H. COASE (1910 - ) Notes biographiques et bibliographiques de la Bud Johnston Library
Archives audio
- The Intellectual Portrait Series: A Conversation with Ronald H. Coase, Interview de Ronald H. Coase par Richard Epstein, en 2002, Indianapolis: Liberty Fund, partie de "The Intellectual Portrait Series: Conversations with Leading Classical Liberal Figures of Our Time"
| Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie. |