Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Alfred Marshall
| Alfred Marshall | |||||
| Économiste | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 1842 - 1924 | ||||
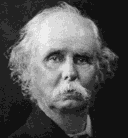
| |||||
| Tendance | |||||
| Nationalité | |||||
| Articles internes | Autres articles sur Alfred Marshall | ||||
| Citation | |||||
| Interwikis sur Alfred Marshall | |||||
Alfred Marshall (Londres 26 juillet 1842 - Cambridge 13 juillet 1924), est l'un des pères fondateurs de l'école néoclassique, et l'un des économistes les plus influents de son temps. Ne pas confondre avec le général américain George Marshall, initiateur du "Plan Marshall" (1947).
Biographie
Il est né à Bermondsey (Londres). Son père était caissier à la Banque d'Angleterre. Il suit d'abord des études scientifiques en mathématiques et en physique avant de s'intéresser à la philosophie et à la théologie. Plutôt radical au début de sa carrière, il se convertit au libéralisme à la suite d'un voyage aux États-Unis, tout en intégrant une certaine morale dans ses propos : « L'économiste, comme tout autre doit se préoccuper des fins dernières de l'homme ».
Après avoir enseigné à Oxford et à Bristol, il poursuivit sa carrière de professeur à Cambridge où il occupa la chaire d'économie politique de 1885 à 1908. Il eut pour élève John Maynard Keynes qui deviendra son principal critique et Arthur Pigou.
Son œuvre
Son livre Principes d'économie politique (1890) a rassemblé les théories de l'offre et la demande, d'utilité marginale et des coûts de production dans une logique cohérente. Celui-ci est devenu le manuel économique dominant en Angleterre pendant une longue période.
Il a également publié Industry and Trade en 1919 et Money, Credit and Commerce en 1924.
La question de la valeur
La question de la valeur économique est une question qui occupait les théoriciens depuis très longtemps, puisque dès le Ve siècle, Saint Augustin s'interrogeait sur la notion de juste prix.
Avant Marshall, les deux grandes théories de la valeur étaient celles :
- des économistes classiques anglais qui privilégiaient une approche macro-économique et avaient analysé les phénomènes de production, et avaient mis en avant la valeur-travail, avec :
- Adam Smith pour qui le prix d'un bien dépend de la rémunération du travail fourni par l'ouvrier qui le fabrique,
- et avec David Ricardo qui avait affiné cette analyse en développant la notion de travail incorporé, qui englobait non seulement le travail de l'ouvrier, mais également le travail nécessaire pour produire les machines et les outils qu'il utilise;
- et celle plus novatrice de Léon Walras et de l'école marginaliste qui initiaient une approche micro-économique et se plaçaient résolument au niveau des consommateurs, en parlant de valeur-utilité, car pour eux seul comptait la satisfaction du consommateur, le prix du bien dépendant de son degré d'utilité :
- si un bien (ou un service) est rare mais jugé très utile par les consommateurs, ceux-ci sont prêts à acquitter un prix élevé, mais ce degré d'utilité décroît au fur et à mesure où le degré de satisfaction du consommateur augmente;
- Parallèlement, le prix qu'un consommateur est prêt à payer baisse au fur et à mesure où son besoin est satisfait, ce qui signifie que plus un bien est produit en grandes quantités, ou quand un service est accessible au plus grand nombre, l'individu y attache de moins en moins d'importance, et il est de moins en moins prêt à payer le prix fort.
Ce sont ces deux théories en apparence opposées et inconciliables qu'il a réussit à fondre en une synthèse, car ces deux approches ne sont contradictoires qu'en apparence, et elles sont en fait complémentaires :
- les classiques proposent une analyse objective de la valeur en se fondant sur les coûts de production,
- alors que les marginalistes privilégient une approche plus subjective en mettant l'accent sur les goûts et les besoins des individus.
Pour Alfred Marshall, le prix d'un bien dépend du coût des facteurs de productions et de la valeur que le consommateur est prêt à lui accorder, et il ne faut pas privilégier une approche plutôt qu'une autre. Pour résoudre ce dilemme, il a introduit la notion de temps dans l'analyse des mécanismes économiques :
- Sur le court terme, l'utilité l'emporte dans le phénomène de fixation du prix, par la recherche de l'équilibre entre l'offre et la demande, lequel s'établit à un prix qui exprime la valeur-utilité. Lors de l'introduction d'un produit sur le marché, l'entreprise adapte ses prix en fonction de la demande.
- Mais, sur le long terme, les coûts de production deviennent déterminants, car l'entreprise est obligé d'en tenir compte, et un prix d'équilibre qui ce situe entre ce que le marché est prêt à payer au maximum et le prix auquel l'entreprise doit vendre son produit au minimum, va correspondre au prix naturel tel qu'il a été défini par les économistes classiques en se fondant sur la valeur-travail.
Les critiques avaient souligné que le concept d'utilité n'étaient guère opérationnel en entreprise, beaucoup moins que celui de la valeur-travail, car la satisfaction du consommateur était difficile à mesurer. Mais, selon Alfred Marshall, ce n'est pas parce que les outils d'analyse n'existent pas qu'il faut faire l'impasse sur la valeur-utilité, car dans la réalité une entreprise ne se lance pas dans la production d'un bien, si elle ne pense pas raisonnablement qu'il ne trouvera pas preneur, soit parce qu'il est trop cher, soit parce qu'il ne correspond pas à un besoin exprimé ou latent.
L'équilibre partiel d'Alfred Marshall
Il a reprit les théories marginalistes et néo-classiques mais s'oppose à l'approche de Léon Walras : il a une approche plus empirique de la réalité et défend l'idée d'équilibre partiel et non général. Pour lui, lorsqu'un marché est équilibré, on a pas forcément l'équilibre dans tous les marchés.
La loi des rendements non proportionnels
Alfred Marshall a aussi travaillé sur deux aspects contradictoires des travaux d'Adam Smith et de David Ricardo :
- Adam Smith avait montré que la productivité d'une entreprise augmente grâce à la division du travail, c'était la loi des rendements croissants.
- De son côté, David Ricardo en examinant le cas particulier de l'agriculture, avait mis en évidence le fait que les meilleures terres sont cultivées en priorité, mais la population augmentant, il faut défricher de nouvelles terres mais dont la productivité est moindre. La nature impose donc des limites à l'activité humaine, c'est la loi des rendements décroissants.
Marshall, cherchait à construire un modèle théorique applicable à un champ d'application général, il ne pouvait donc se satisfaire de lois assorties d'exception ou de lois ne s'appliquant qu'à des cas particuliers. Pour lui une entreprise est soumise simultanément à ces deux lois : elle cherche à améliorer sa productivité par une meilleure organisation du travail, mais se heurte aux limites du monde physique ou de ses ouvriers. Ses rendements sont en premier décroissant puis croissant dans un second temps, c'est la loi des rendements non proportionnels.
L'interventionnisme de l'État
Alfred Marshall s'est aussi penché sur la question de savoir comment une subvention ou un impôt pouvait influer sur le degré de satisfaction des consommateurs.
À l'encontre de son élève John Maynard Keynes qui pensait que l'intervention massive de l'État était importante pour relancer l'activité économique en temps de crise, Marshall, ardent défenseur du «laisser faire, laisser passer», pensait que l'intervention de l'État n'était bénéfique que pour encourager les productions rentables mais était contre-productive pour les activités en perte de vitesse qui ne devaient pas être soutenues inutilement.
Croyant aux vertus de la libre-concurrence, il pensait que les entreprises devaient subir une sorte de sélection naturelle afin que seules subsistent celles qui étaient capables de s'adapter au marché. Pour réussir, alors qu'elles subissent la loi des rendements non proportionnels, elles doivent être capables de dégager en priorité, des économies internes, d'augmenter leur production et d'accroître leur part de marché, avant de bénéficier d'apports externes. La disparition d'entreprises concurrentes leur permet de développer naturellement leur activité sur le marché.
Quelques autres idées
Il fut réticent devant l'importance croissante du pouvoir syndical qui, pour défendre les intérêts des ouvriers, menacent de bureaucratiser la société et d'entraver la libre-entreprise en imposant des règlementations sociales trop rigides.
Par contre il était très favorable à la généralisation de la formation, afin de réduire le nombre d'ouvriers non qualifiés. Il pensait que seule la formation pouvait réellement améliorer leur bien-être par de meilleurs salaires et par une valorisation de leur position sociale.
Conclusion
Dans Les Principes de l'économie politique il a défini la tâche de la science économique : «Nous devons étudier l'humanité telle qu'elle est. Nous ne devons pas construire un monde irréel, tel qu'il pourrait ou devrait être». Pour lui, l'idéal était de bâtir une théorie qui rende fidèlement compte de cette réalité, si complexe et si réfractaire à toute réduction, qu'il est important que la science économique ne soit jamais une science figée par des dogmes et que toutes les critiques et doutent puissent s'exprimer, car de cette façon, ils seront salutaires.
Citation
- «L'Économie politique ou l'Économique est une étude de l'humanité dans l'activité ordinaire de la vie. Elle étudie ce qui, dans l'individu ou l'action sociale, est relié à la recherche et à l'utilisation des moyens matériels nécessités par le bien être».
Voir aussi
Œuvres
- 1890, Principles of Econmics [Principes d'économie politique],
- 1898, 'Distribution and Excahnge', Economic Journal, VIII (29), March, pp37-59
- 1904, On a National Memorial to Herbert Spencer, Daily Chronicle, 23 Nov.
- 1919, Industry and Trade,
- 1924, Money, Credit and Commerce,
- 1925, Mechanical and biological analogies in economics, In: Arthur C. Pigou, dir., Memories of Alfred Marshall, London, Macmillan, p. 314
Littérature secondaire
- 1931, Talcott Parsons, "Wants and Activities in Marshall", The Quarterly Journal of Economics, Vol 46, n°1, pp101-140
- 1942, G. F. Shove, "The place of Marshall’s Principles in the Development of Economic Theory", The Economic Journal, Vol 52, n°208, Dec., pp294-329
- 1950, R. Frisch, “Alfred Marshall’s Theory of Value”, Quarterly Journal of Economics, Vol 64, n°4, pp673–690
- 1986, D. Reisman, "The Economics of Alfred Marshall", London: Macmillan
- 1987, Levy, David, "Marshal, Orthodoxy and Professionalisation of Economics", The Journal of Economic History, 47:871-872
- 1993,
- John Foster, Economics and the Self-Organization Approach: Alfred Marshal Revisited?, The Economic Journal, 103:975-991
- Geoffrey M. Hodgson, 'The Mecca of Alfred Marshall', Economic Journal, 103 (2) March, pp406-415
- 1998, Claire Charbit, Richard Arena, "Marshall, Andrews and Robinson on Markets: An Interpretation", In: Nicolai J. Foss, Brian Loasby, dir., "Economic Organization, Capabilities, and Coordination: Essays in Honour of George B. Richardson", Routledge: London/New York, pp83-103
- 1999,
- Patrik Aspers, "The Economic Sociology of Alfred Marshall: An Overview", American Journal of Economics & Sociology, Vol 58, pp651-667
- Michel R. De Vroey, "Marshall on Equilibrium and Time: A Reconstruction", The European Journal of the History of Economic Thought, vol 7, n°2, pp245–269
- Jean-Pierre Potier, « Libéralisme et socialisme dans la pensée d’Alfred Marshall », In: Maurice Chrétien, dir., "Le nouveau libéralisme anglais à l’aube du XXe siècle", Paris : Economica, pp149-162
- 2003, Gilles Dostaler, "Alfred Marshall, le frère ennemi de Walras", Alternatives économiques, n°214, mai, pp76-78
- 2000, John Finch, "Is post-Marshallian economics an evolutionary research tradition?", European Journal of the History of Economic Thought, vol 7, pp377-406
- 2003,
- Peter Groenewegen, Gianni Vaggi, "Alfred Marshall, 1842–1924: Partial Equilibrium and Useful Economics", In: Peter Groenewegen, Gianni Vaggi, dir., "A Concise History of Economic Thought. From Mercantilism to Monetarism", Palgrave, pp227-234
- A. Lavezzi, "Smith, Marshall and Young on division of labour and economic growth", European Journal of the History of Economic Thought, Vol 10, pp81-108
- 2008, Neil B. Niman, "Charles Babbage’s Influence on the Development of Alfred Marshall’s Theory of the Firm", Journal of History of Economic Thought, Vol 30
- 2009, Anastassios D. Karayiannis, "The marshallian entrepreneur", History of Economic Ideas, Vol 17, n°3, pp75-102
- 2011,
- Richard N. Langlois, “Marshall’s (Real) Influence on Present-day Industrial Economics”, In: Tiziano Raffaelli, Tamotsu Nishizawa et Simon Cook, dir., "Marshall, Marshallians and Industrial Economics", London: Routledge
- Tiziano Raffaelli, Tamotsu Nishizawa et Simon Cook, dir., "Marshall, Marshallians and Industrial Economics", London: Routledge
- 2012, Jacques-Laurent Ravix, "Alfred Marshall and the Marshallian Theory of the Firm", In: Michael Dietrich, Jackie Krafft, dir., "Handbook on the Economics and Theory of the Firm", Edward Elgar Publishing
Lien externe
En français
- (fr)Principes d'économie politique
- (fr)Marshall déguisé en Pareto par David Friedman
- (fr)Alfred Marshall, le frère ennemi de Walras Gilles Dostaler, Alternatives Economiques n° 214 - mai 2003
| Accédez d'un seul coup d’œil au portail économie. |