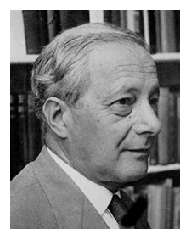Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Michael Polanyi
Michaël Polanyi (11 mars 1899 - 22 février 1976) est un chimiste et épistémologue britannique d'origine hongroise.
Biographie
Né en Autriche-Hongrie, il part pour la Grande-Bretagne après la chute de l'Empire. Issu d'une lignée de scientifiques, il poursuit lui-même des études de chimie, matière qu'il enseignera à l'Université de Manchester de 1933 à 1948. Il est considéré comme un futur nobélisable.
C'est alors qu'il change d'orientation pour se tourner vers les sciences sociales, qu'il enseigne jusqu'en 1958 dans la même université, avant d'obtenir le titre de Senior Research Fellow au Collège Merton de l'Université d'Oxford.
Ses idées
La liberté scientifique
Dans Logic of Liberty (1951), Polanyi entreprend tout d'abord de dénoncer le dévoiement intellectuel qui a permis aux gouvernements de faire main basse sur la recherche scientifique.
L'intervention étatique brise le développement naturel du travail scientifique. Celui-ci se décompose en trois temps : à titre individuel, les savants choisissent leur thème de recherche et s'y consacrent. Ensuite, les autres membres de la communauté scientifique participent aux recherches pour les affiner, les corriger ou même en refuser les résultats provisoires - mais toujours à l'intérieur de critères scientifiques indépendants de toute volonté politique. Enfin, le débat public peut commencer à travers les publications et articles de vulgarisation. Au cours de ces échanges, chacun acceptera librement ou non les conclusions des travaux.
Le problème apparu avec le marxisme est son rejet intégral d'une science indépendante de la "demande sociale". Plus généralement, Polanyi remarque qu'en quelques années, le dogme d'une science devant oeuvrer pour le "bien-être de l'humanité" s'est substitué à la tradition millénaire d'une science désintéressée. Et l'auteur de citer, à l'appui de sa réflexion, quelques titres d'ouvrages fort populaires au moment de la rédaction de son livre : Science for Citizen d'Hogben; Social Relations of Science de J. G. Crowther; Social Functions of Science de J. D. Bernal.
En d'autres termes, c'est l'ancienne distinction entre science pure et science appliquée qui a été violemment niée par les intellectuels étiquettés progressistes. L'objectif véritable de cette contestation est de justifier la planification de la science.
Pour démontrer que cette distinction reste pourtant inévitable, Polanyi en donne une explication d'ordre économique :
- La science appliquée nous montre comment obtenir des avantages pratiques en faisant usage des ressources matérielles. Mais il y a une limite à la désirabilité de tout avantage pratique particulier et il y a une limite à l'abondance de toute ressource particulière. Une technologie ne vaut plus rien en cas de chute brutale de la demande du produit qu'elle détermine ou d'un effondrement de l'offre de la matière première qu'elle utilise. Dès qu'elle produit des biens qui valent moins que les matériaux utilisés, le procédé devient techniquement absurde. Une invention qui serait conçue pour produire des désavantages pratiques n'est pas une invention, ni pour le sens commun ni au sens des lois sur la propriété industrielle. Au contraire, la science pure n'est pas affectée par les variations de l'offre et de la demande. Cela peut modifier légèrement l'intérêt que présente telle ou telle de ses branches, sans pour autant invalider la moindre de ses parties : rien de ce qui était vrai ne deviendra dénué de sens, ni l'inverse.
Pour réfuter par l'exemple la théorie marxiste, selon laquelle chaque nouvelle étape du développement scientique consiste en une nouvelle réponse à une "demande sociale", Polanyi explique que les lois newtoniennes de la gravitation n'ont pas été découvertes pour répondre aux intérêts maritimes britanniques, comme le prétendent les économiques marxistes et leurs suiveurs. C'est en effet oublier que Newton s'est appuyé sur les réflexions d'illustres prédécesseurs, qui habitaient et travaillaient loin de la mer : Copernic (à Heidelberg); Kepler (à Prague); Galilée (à Florence). De même, les conclusions de Newton ont énormément intéressé des chercheurs suisses ou prussiens - peu concernés par les questions navales.
De même, il est impossible de savoir à quelles applications éventuelles les Planck, Einstein, Rutherford ou Schrödinger pouvaient bien songer en élaborant leurs nouvelles théories.
L'utilitarisme et le marxisme sont donc les deux menaces qui ont sapé l'indispensable autonomie du travail scientifique pour le subordonner au pouvoir et à l'organisation étatiques.
La liberté du savant contredit donc les thèses des planistes, lesquels se figurent que l'on peut organiser la science comme on établit le plan d'une maison. Pour encore mieux faire comprendre son propos, Polanyi reprend une métaphore proposée par Milton dans son Areopagitica (1644). D'après le grand penseur et poète anglais, la vérité pourrait être représentée par une statue réduite en mille morceaux, dispersés et cachés en des endroits éloignés les uns des autres. Chaque savant, de sa propre initiative, recherche un fragment pour le remettre à sa place, auprès des autres pièces déjà rassemblées par ses autres confrères.
La planification impossible
A travers sa réflexion épistémologique et politique, Polanyi démontre la supériorité de l'ordre polycentrique (self-adjusted order) sur toute organisation sociale reposant sur le centralisme et le monopole bureaucratique (corporate order). Plus encore, il estime qu'il n'est pas d'autre forme à long terme viable d'organisation sociale que celle reposant sur la liberté individuelle.
Contrairement aux thèses défendant la mainmise de l'Etat sur l'activité scientifique, Polanyi argumente que seules la concurrence intellectuelle et la coopération volontaire permettent l'essor des sociétés humaines et leur prospérité.
Mais il va plus loin, en estimant qu'une société obéissant totalement à des principes d'organisation centralisée est rigoureusement impossible. Car cette conception administrative (réglementation des prix, centralisation de la recherche scientifique, etc.) de la société romprait toute communication véritable entre chaque individu et, par voie de conséquence, finirait par faire sombrer dans le chaos l'ensemble de la communauté. Le planisme constitue une utopie irréalisable, car il sape tout système véritable d'information et n'offre qu'un simulacre de contrôle sur la production, au contraire d'un système auto-ajusté, fondé sur une communication libre entre chaque acteur. Seuls les participants à un marché libre interagissent réellement en échangeant des informations authentiques.
Polanyi exprime ainsi la supériorité du système auto-organisé sur l'administration planificatrice :
- On est confronté ici avec l'immense supériorité quantitative d'un système d'ordre spontané. Quand la taille d'un tel système croît, il peut en résulter une augmentation presque sans limite du taux de régulation des relations per capita. Ceci tranche avec le cas des systèmes organisés, dont l'augmentation de taille n'élève pas réellement le nombre de relations pouvant être régulées par personne et par unité de temps.
Pour mieux faire comprendre l'échec inéluctable d'une économie administrée, à la structure nécessairement pyramidale, il recourt à une métaphore éloquente :
- Une autorité qui serait chargée de remplacer par une gestion délibérée les fonctions d'un grand système auto-organisé serait donc placé dans la situation d'un homme chargé de conduire d'une seule main une machine dont le fonctionnement requiert l'emploi simultané de plusieurs milliers de leviers. Les pouvoirs légaux qu'aurait une telle autorité ne lui serviraient à rien dans cette tâche; en voulant les faire respecter, quoi qu'il arrive, on ne pourrait que paralyser un système qu'on n'arriverait pas à gérer.
Pour illustrer la supériorité d'un système dans lequel les interconnexions entre les individus s'opèrent spontanément, il se sert d'un autre exemple :
- Songeons, par exemple, aux consommateurs de gaz à un moment où il y a une pénurie se traduisant par une baisse anormale de la pression. Un grand nombre d'entre eux ne pourront chauffer l'eau de leur bain à une température acceptable et préféreront, dans ces conditions, ne pas prendre de bain du tout. Toute personne décidant, compte tenu de de la pression du gaz à ce moment, de prendre ou de ne pas prendre un bain, affectera directement la décision de tous les autres consommateurs, en train de chercher, au même moment, une solution au même problème. On a ici un système d'ajustements mutuels dont chacun affecte des milliers de relations.
En d'autres termes, chaque décision délivre une information, qui circule à travers tout le réseau interindividuel. En retour, chaque récepteur de la nouvelle information prendra une décision qui entraînera elle-même un nouvel effet, et ainsi de suite.
Libertés publiques et libertés privées
La question de la liberté est donc l'enjeu de sa réflexion. Mais Polanyi ne la réduit pas à une opposition individu/société (ou collectivité). La véritable raison d'être de la liberté n'est pas qu'elle permettrait à chacun de vivre isolément selon ses inclinations personnelles, du moins pas seulement.
En réalité, la liberté est un vecteur d'information entre chacun de nous, en même temps que la condition nécessaire à l'existence d'un lien social digne de ce nom. Dès lors, il ne s'agit pas simplement de refuser la mainmise de l'Etat sur les décisions individuelles au motif qu'elle empêche effectivement l'homme d'agir pour lui-même, mais - plus profondément - il faut la refuser parce qu'elle détruit les conditions de possibilité d'une vie sociale civilisée. Le socialisme favorise donc l'émergence d'une société atomisée, où chaque individu vit replié sur lui-même, sur sa vie privée (dans son double sens, puisque chacun est privé de toute communication libre avec autrui). Au contraire, le libéralisme a pour raison d'être la perpétuation d'une société d'individus interagissant dans un monde dont la complexité est à la fois cause et effet de leurs actions (et, partant, justification de la préservation des libertés publiques).
L'auto-destruction du libéralisme
Partant de ces considérations, le savant se demande pour quelles raisons le XXe siècle a vu le socialisme s'imposer au lieu du libéralisme.
D'après lui, l'Europe a été rongée par le démon totalitaire à cause de la substitution des passions et désirs matérialistes aux idéaux élevés de la raison, de la morale et de la religion. Cette éviction s'est produite à la suite de contradictions internes au libéralisme, estime Polanyi. En effet, la systématisation du doute philosophique et la glorification d'un certain scepticisme a accordé une valeur égale entre moralité et immoralité; vérité et mensonge; piété et impiété; liberté et licence; pitié et cruauté; etc. Le processus a été enclenché au Siècle des Lumières quand l'homme s'est vu attribuer un rôle démiurgique, auquel a dû céder la place son antique dignité de serviteur d'idéaux. Dès lors, l'émancipation humaine à l'égard de toute idée transcendante de justice et de vérité a jeté l'Europe sur la route de la servitude. En revanche, continue-t-il, le caractère fortement religieux du libéralisme anglo-saxon l'a préservé de cette pente fatale.
Ce triomphe de la philosophie matérialiste s'est ensuite combiné avec la montée d'un nihilisme - destructeur de principes supérieurs - pour former les différentes idéologies totalitaires : marxisme, fascisme, national-socialisme.
Ceci étant, poursuit Polanyi, le caractère sans précédent du phénomène totalitaire, fondé sur un athéisme radical, a fini par être reconnu. Dès lors, le philosophe regarde avec espoir l'avenir de l'Europe en notant que le combat anticlérical de nombreux libéraux se fait progressivement plus discret, ceux-ci admettant la nécessité de normes supérieures à la volonté humaine.
Citations
- Il apparaît, en premier lieu, que l'opposition habituelle individu-Etat est insuffisante pour penser le rapport entre liberté et totalitarisme; en tout cas, les libertés les plus essentielles ne sont pas celles qui consistent pour l'individu à exiger de l'Etat qu'il lui permette d'agir selon ses propres intérêts. La liberté est le droit qu'a un individu ayant une vocation d'exiger qu'on lui laisse faire ce qu'il a vocation à faire. Il s'adresse à l'Etat sur le ton d'un homme vassal d'un maître supérieur exigeant qu'on rende hommage à son maître. La vraie opposition est donc entre l'Etat et les réalités invisibles qui guident les efforts créateurs des hommes et où s'enracinent naturellement leurs consciences. La cohérence et la liberté de la société ne sont assurées qu'en proportion de la foi qu'ont les hommes dans la vérité, la justice, la charité et la tolérance et de la volonté qu'ils ont de se consacrer au service de ces réalités; au contraire, il faut s'attendre à ce que la société se désintègre et tombe en servitude lorsque les hommes nient, dsqualifient intellectuellement, ou simlement négligent ces réalités et ces obligations transcendantes. C'est de la négation de la réalité de ce règne des idées transcendantes que naît logiquement l'Etat totalitaire. Quand les fondements spirituels de toutes les libres vocations humaines - avancement de la science et du savoir en général, exigence de justice, affirmation de la religion, libre pratique des arts et de la discussion politique - quand les étais transcendants de toutes ces libres activités sont sommairement rejetés, c'est alors sur l'Etat que, de de toute nécessité, se reportent toutes les ferveurs dont l'homme est capable. Car si la vérité n'est pas quelque chose de réel et d'absolu, alors il peut paraître raisonnable que les pouvoirs publics décident de ce qui devrait être estimé vrai. Et si la justice n'est pas quelque chose de réel et d'absolu, alors il peut paraître raisonnable que l'Etat décide de ce qui devrait être considéré comme juste ou injuste.
- L'effondrement de la liberté qui est partout survenu après le succès de ces attaques démontre par les faits ce que j'ai dit auparavant : à savoir que la liberté de pensée devient vaine et ne peut que disparaître là où la raison et la moralité sont privées de leur statut de forces autonomes. Lorsque le juge en son tribunal ne peut plus en appeler au droit et à la justice; lorsque ni un témoin, ni un journaliste, ni même un scientifique rendant compte de ses expériences, ne peut dire la vérité telle qu'il la connaît; lorsque, dans la vie publique, il n'existe plus de principe moral imposant le respect; lorsqu'on dénie toute substance aux révélations de la religion et de l'art; alors il ne reste plus de sol sur lequel un individu puisse prendre appui pour résister aux gouvernants du jour. Le totalitarisme est ici logique avec lui-même. Un régime nihiliste devra assurer la gestion quotidienne de toutes les activités qui, en temps ordinaire, sont guidées par les principes intellectuels et moraux que le nihilisme déclare nuls et vides; les principes doivent être remplacés par les décrets de l'omni-compétente Ligne du Parti.
- Il me semble que ces idées diverses, mouvantes et obscures sur la planification économique souffrent toutes du même défaut de base. Elles sont fondées sur la totale méconnaissance du fait qu'un système industriel géré de façon centralisée est impossible à administrer - impossible au sens où il est impossible pour un chat de traverser l'Atlantique à la nage.
- Ce qui caractérise une société libre, c'est l'éventail des libertés publiques à travers lesquelles l'individu peut jouer socialement tout son rôle, et non le champ laissé aux libertés personnelles sans effet social. Inversement, le totalitarisme n'a pas pour intention première de détruire toute liberté privée; ce sont les libertés publiques, bien plutôt, qu'il prend pour cible. En effet, dans la conception totalitaire, les actions personnelles indépendantes ne sont jamais de nature à réaliser une fonction sociale; quant aux responsabilités publiques, elles incombent toutes à l'Etat. Alors que la conception libérale de la société accorde au contraire un rôle décisif, dans la vie publique des nations, à la liberté individuelle. Ces considérations obligent à remettre en cause la distinction entre les deux aspects, public et privé, de la liberté. Certes, tous deux doivent être protégés; mais il est fatal au premier d'être fondé sur le second et d'être, comme cela arrive souvent, revendiqué en son nom.
- La liberté de la personne égocentrique qui veut agir selon son bon plaisir est mise en échec par la liberté de la personne rationnelle qui agit selon ce qu'elle doit.
Voir aussi
Liens externes
- Polanyiana, le périodoque de la Michaël Polanyi Liberal Philosophical Association (en hongrois, mais certains articles sont disponibles en anglais).
- Site de la Polanyi Society (en)
- Biographie de M. Polanyi (en)
- Présentation de son oeuvre et de ses idées (en)
- Brève présentation sur le site du Acton Institute (en)
- Michaël Polanyi and Tacit Knowledge (en)
- La Théorie de la production ostentatoire (trad. par Hervé de Quengo) (fr)
| Accédez d'un seul coup d’œil au portail des grands auteurs et penseurs du libéralisme. |