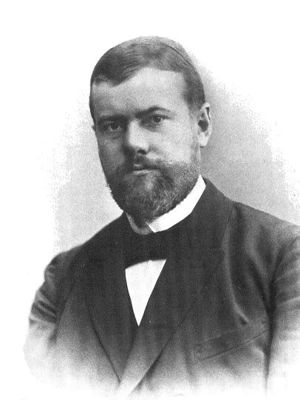Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Différences entre les versions de « Max Weber »
| Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
* [[1980]], Stephen Kalberg, Max Weber’s Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rational Processes in History, American Journal of Sociologie, 85, 3, pp1145-1179 | * [[1980]], Stephen Kalberg, Max Weber’s Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rational Processes in History, American Journal of Sociologie, 85, 3, pp1145-1179 | ||
* [[1981]], Anna Elisabetta Galeotti, Tipi del potere e forme del sapere in Max Weber, Quaderni della Fondazione Feltrinelli, 13 | * [[1981]], | ||
** Anna Elisabetta Galeotti, Tipi del potere e forme del sapere in Max Weber, Quaderni della Fondazione Feltrinelli, 13 | |||
** Anna Elisabetta Galeotti, Ordine e ordinarietà: norma giuridica e regole dell’azione sociale in Max Weber”, Sociologia del Diritto, VIII, 1 | |||
* [[1988]], W. Hennis, Max Weber. Essays in Reconstruction. London: Allen & Unwin | * [[1988]], W. Hennis, Max Weber. Essays in Reconstruction. London: Allen & Unwin | ||
Version du 25 août 2009 à 21:53
| Max Weber | |||||
| sociologue | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 1864 - 1920 | ||||
| Tendance | |||||
| Nationalité | |||||
| Articles internes | Autres articles sur Max Weber | ||||
| Citation | |||||
| Interwikis sur Max Weber | |||||
Max Weber (21 avril 1864 à Erfurt - Munich le 14 juin 1920) est un économiste et sociologue allemand, considéré comme l'un des fondateurs, avec Karl Marx et Émile Durkheim), de la sociologie moderne. Sa réception a toutefois été lente, particulièrement en France. Sa stature ne s'impose, en Allemagne, qu'une dizaine d'années après sa mort, de même qu'aux États-Unis, notamment grâce au grand sociologue Talcott Parsons qui s'inspire de Weber dans sa théorisation de l'action sociale et qui traduit l'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme en anglais. En France, la domination de l'école durkheimienne avant guerre, puis la prégnance de la pensée marxiste après guerre permettent d'expliquer la lenteur de la réception d'une œuvre qui était, pour une large part, en opposition avec ces deux courants de pensée. C'est essentiellement à Raymond Aron que l'on doit (notamment grâce à son ouvrage les Étapes de la pensée sociologique paru en 1967) la découverte, en France, de Max Weber. Depuis, l'œuvre weberienne n'a cessé d'exercer son influence sur l'ensemble de la sociologie française : ainsi, des figures aussi opposées que celle de Raymond Boudon et de Pierre Bourdieu s'en réclament. Les traductions françaises, longtemps lacunaires et de mauvaise qualité, ont connu, depuis une dizaine d'années, un fort développement. On peut voir, dans cette activité éditoriale, l'importance toujours croissante et l'actualité jamais démentie d'une pensée sociologique de premier plan.
Max Weber est considéré comme le fondateur de la sociologie compréhensive, c'est-à-dire d'une approche sociologique qui fait du sens subjectif des conduites des acteurs le fondement de l'action sociale. Son œuvre est dominée par une recherche sur la rationalité, et, plus spécifiquement, sur le processus de rationalisation de l'action pratique dans le monde qui lui semble être la spécificité de l'Occident moderne — processus marqué, en particulier, par la naissance et le développement du capitalisme. Il travailla aussi sur de nombreux objets, souvent liés à sa réflexion sur la rationalité, comme la domination, la bureaucratie, le droit, etc. Toutefois, l'essentiel de son œuvre de sociologue est constitué par une sociologie des religions : il considérait, en effet, que les religions ont apporté une contribution décisive à la rationalisation du monde.
- « Ce qui importe donc, en premier lieu, c'est de reconnaître et d'expliquer dans sa genèse la particularité du rationalisme occidental [...]. L'apparition du rationalisme économique [...] dépend de la capacité et de la disposition des hommes à adopter des formes déterminées d'une conduite de vie caractérisée par un rationalisme pratique. Là où une telle conduite de vie a rencontré des entraves d'ordre psychique, le développement d'une conduite de vie rationnelle dans le domaine économique a rencontré, lui aussi, de fortes résistances intérieures. Or, parmi les éléments les plus importants qui ont façonné la conduite de vie, on trouve toujours, dans le passé, les puissances magiques et religieuses ainsi que les idées éthiques de devoir qui sont ancrées dans la croyance en ces puissances » (« Avant-propos » du Recueil d'études de sociologie des religions (1920)).
Eléments d'épistémologie
L'épistémologie de Max Weber est d'une très grande sophistication et complexité. On ne rendra compte ici que de quelques-uns de ses éléments. Alors que pour Durkheim la sociologie doit s'établir sur des méthodes propres, mais fondées sur les sciences de la nature, Weber pense que la sociologie, tout comme l'histoire ou l'économie politique, fait partie des « sciences de la culture ». Pour Weber, ces sciences sont trop éloignées des sciences de la nature pour qu'elles puissent s'inspirer de leurs méthodes.
Comme le note Raymond Aron dans Les étapes de la pensée sociologique (1967), « les caractères originaux de ces sciences sont [pour Max Weber] au nombre de trois : elles sont compréhensives, elles sont historiques et elles portent sur la culture. » Les sciences de la culture sont compréhensives parce que les actions humaines sont constituées par les processus par lesquels les hommes donnent un sens subjectif au monde, et orientent leur activité en fonction de celui-ci. Pour rendre compte des actions humaines, il faut donc comprendre les intentions et les motifs subjectifs qui sont à leur origine. Les sciences de la culture sont, d'autre part, nécessairement historiques parce que le sens subjectif qui constitue les actions humaines est toujours structuré à partir d'une situation historique donnée. Le fait que les sciences de la culture s'intéressent à la culture semble aller de soi. Ce que Weber veut dire, c'est que les actions humaines, étant des actions subjectives, se constituent dans le cadre d'un univers de sens, c'est-à-dire d'une culture et, donc, qu'elles se définissent par rapport à des valeurs et créent elles-mêmes des valeurs.
Ce dernier point pose un certain nombre de problèmes épistémologiques, sur lesquels Max Weber a apporté une réflexion décisive. Si les sciences sociales ont pour objet la culture, elles sont constituées elles-mêmes dans le cadre d'une culture, c'est-à-dire de valeurs. Dès lors, comment peuvent-elles échapper aux évaluations normatives, fondées sur des valeurs, sur leur objets et prétendre à l'objectivité ? Pour surmonter ce problème, Weber opère la distinction entre « jugements de valeurs » et « rapports aux valeurs ». Alors que les premiers sont subjectifs et ne doivent pas avoir de place dans le travail scientifique (à l'exception du moment où le chercheur choisit son objet, en raison de la valeur qu'il lui accorde), le « rapport aux valeurs » signifie que l'analyse d'une réalité sociale doit tenir compte de la place occupée par les valeurs dans la société analysée, sans porter de jugement normatif sur celles-ci. L'activité scientifique n'est elle-même orientée par aucune valeur, à l'exception de celle de la vérité.
Le fait que les sciences sociales soient des sciences de la culture pose un autre problème fondamental, auquel Max Weber apporte une réponse par son concept d'idéal-type. Pour lui, les sciences de la culture font face à l'infinité du flux historique : le monde de la culture est constituée d'une infinité de faits et une multiplicité inextricable de causes. Toute analyse doit donc se fonder sur un travail préalable de purification du réel, par lequel le chercheur construit ses objets et ses catégories d'analyse en simplifiant et en systématisant les traits qui sont pour lui, en fonction de sa problématique, essentiels. Par ce travail de grossissement et d'idélisation des traits qui lui semblent fondamentaux, le chercheur construit des idéaux-types, grâce auquel il pourra guider sa recherche. Ceux-ci forment des « tableaux de pensée homogène », où l'on a rassemblé, en une définition cohérente, l'ensemble des traits, pas nécessairement les plus courants, mais les plus spécifiques et les plus distinctifs pour caractériser l'objet. En ce sens, l'idéal-type est toujours une « utopie » comme l'indique Weber : mais c'est pour cela qu'il constitue un instrument d'intelligibilité fondamental. Son caractère utopique est ce qui permet de lire le réel, d'y repérer l'objet sous ses différentes formes empiriques, et de l'analyser en considérant son écart par rapport à son type-idéal.
La sociologie compréhensive
« Nous appelons sociologie une science qui se propose de comprendre par interprétation l'action sociale et par là d'expliquer causalement son déroulement et ses effets. » Telle est la définition de la sociologie que Weber propose dans les premières pages d' Economie et société. Par cette définition, il fait de la sociologie une science de l' action sociale, en opposition à l'approche holiste de Durkheim, pour qui la sociologie est science des faits sociaux.
Pour Weber, le monde social est constitué par l'aggrégation des actions produites par l'ensemble des agents qui le composent. L'unité de base de la sociologie est donc l'action sociale d'un agent. Cette approche individualiste se fonde sur la conviction que les sciences sociales (que Weber nomme « science de la culture ») diffèrent des sciences de la nature, en ce que l'homme est un être de conscience, qui agit en fonction de sa compréhension du monde, et des intentions qu'il a. Analyser le social, c'est donc partir de ces actions et des intentions qui les constituent. D'où la définition que Weber propose de l'action : « nous entendrons par « action » un comportement humain quand et pour autant que l'agent lui communique un sens subjectif. » Dans l'ensemble des comportements des hommes, la sociologie ne s'intéresse ainsi qu'à ceux qui sont le produit d'un sens subjectif (et qui sont les seuls à être qualifiables d'action). Weber ajoute une nouvelle restriction : parmi ces actions construites par un sens, la sociologie ne prend en compte que les actions proprement sociales, c'est-à-dire les actions dont le sens est orienté vers autrui (vers d'autres acteurs sociaux, quelqu'ils soient). Ainsi, pour Weber, la collision accidentelle de deux cyclistes n'est pas une action sociale. La sociologie doit donc être compréhensive en ce sens que le but de la sociologie étant de rendre compte des actions des individus, elle ne peut y parvenir qu'en comprenant le sens, et plus spécifiquement, les motifs qui en sont à l'origine.
La seconde partie de la définition de la sociologie par Weber est souvent mise de côté. Elle est pourtant essentielle, et fait la spécificité de la sociologie compréhensive weberienne. Pour Weber, la sociologie n'est pas qu'une science de la compréhension, elle vise aussi à « expliquer le déroulement et les effets » de l'action. Qu'est-ce que cela signifie ? Premièrement, cela veut dire que pour Weber, il faut vérifier, en faisant ressortir des régularités objectives, que l'interprétation du sens d'une action que l'on propose est la bonne. D'autre part, que le sens de l'action expliquée, il faut ensuite mener une analyse causale des conséquences (qui sont, pour Weber, le plus souvent non voulues, non conformes aux intentions de l'acteur) qu'a cette action.
Weber, dans son analyse des motifs des actions, propose sa célèbre typologie des déterminants de l'action. Pour Weber, les actions sociales ressortissent à quatre types fondamentaux : l'action peut être a) traditionnelle b) affectuelle c) rationnelle en valeur ou, enfin, d) rationnelle en finalité. L'action traditionnelle correspond aux types d'actions quasi « reflexes », « mécaniques » qui sont le produit de l'habitude, et où le sens et les motifs constitutifs de l'action ont, pour ainsi dire, disparus par répétition. Paradoxalement, Weber, qui fait du sens, au moins relativement conscient, le déterminant de l'action, indique que ce type d'action, où le sens a disparu, est le plus courant. L'action affectuelle est le type d'acte commis sous le coup d'une émotion. L'action rationnelle en valeur correspond aux actions par lesquelles un acteur cherche à accomplir une valeur. Cette valeur vaut, pour l'acteur, absolument : il ne se soucie pas des conséquences que peut avoir son action -seul lui importe l'accomplissement des exigences nées de la valeur qui est, pour lui, fondamentale. Un homme prêt à affronter un duel pour sauver son honneur, au prix possible de sa mort ; un capitaine de navire ne le quittant qu'en dernier lors d'un naufrage ; un chrétien prêt à se retirer de la vie dans un monastère ; sont autant d'exemples de ce type d'actions construites par la recherche de l'accomplissement d'une valeur. La spécificité de l'analyse de Weber est qu'il insiste sur le fait que si le but de ce type d'action (la valeur) est irrationnel, les moyens choisis par l'acteur ne le sont pas : c'est en cela que l'action est rationnelle en valeur. Enfin, l' action rationnelle en finalité correspond aux types d'action où l'acteur détermine rationnellement à la fois les moyens et les buts de son action. Un chef d'entreprise efficace agit en fonction de ce type de rationalité, par exemple : il ne se soucie pas des conséquences morales de ses actes (licenciements, par exemple), seul lui importe l'efficacité, déterminée rationnellement, de ses actions. Pour Weber, ce type d'action est le seul véritablement compréhensible.
La rationalisation
Weber accorde une grande importance au processus de rationalisation du monde. Pour lui, les principales civilisations du monde ont connu un processus de rationalisation, par lequel les actions et les représentations des hommes sont devenues plus systématiques et méthodiques. Toutefois, il lui semble que ce processus a atteint un stade plus avancé en Occident et, surtout, que la rationalisation y a connu une direction spécifique. Pour Weber, le monde occidental se caractérise, en effet, par une rationalisation orientée vers l'action pratique dans le monde, c'est-à-dire par une volonté de contrôle et de domination systématique de la nature et des hommes. Au cœur de ce rationalisme de l'action pratique, se trouve le capitalisme, c'est-à-dire le système économique apparu en Occident à la fin du Moyen-Age, qui constitue, pour Weber, l'organisation économique la plus puissante et la plus rationnelle dans la production de biens matériels. Toutefois, si le rationalisme économique est la puissance dominante au sein de ce processus de rationalisation, celui-ci affecte l'ensemble des sphères de l'action, à commencer par les actions sociales élémentaires. En effet, pour Weber, la rationalisation a pour conséquence le développement des actions de type rationnelle en finalité, où buts et moyens sont sélectionnés en fonction de leur seule efficacité -et non de leur contenu moral, par exemple. Cela tend à rendre les relations sociales à la fois impersonnelles, instrumentales et utilitaires : dans leurs relations, les acteurs ne se considèrent que comme des moyens impersonnels dans la poursuite de fins.
Fortement lié à ce processus de rationalisation, est le phénomène de désenchantement du monde : pour Weber, le monde occidental se caractérise par la disparition de la croyance en la magie et, plus largement, par l'effacement de la croyance dans l'action de Dieu dans le monde. Les événements du monde sont considérés comme le pur produit de forces physiques, dont la compréhension est, en principe, toujours accessible à l'homme. Le monde en vient ainsi à être considéré comme dépourvu de sens, étant un pur méchanisme physique sans intention. Le désenchantement du monde a comme effet une vacance du sens : la signification fondamentale du monde, de l'existence, a disparu pour l'homme moderne.
Dans son analyse du processus de rationalisation de l'Occident moderne, Weber insiste sur le fait que la transformation des dispositions mentales, ou ethos, des acteurs a joué un rôle crucial. La rationalisation de l'action naît avant tout de la modification des principes d'action (notamment éthiques) gouvernant la conduite de vie des hommes (comme le rappelle la citation de l'"Avant-propos" supra). Ainsi, dans son analyse de la naissance du capitalisme, Weber fait peu de place à la modification des moyens de production (ce qui constitue l'analyse de Marx) : pour lui, le capitalisme est principalement né de l'apparition d'une nouvelle éthique économique, trouvant son origine dans la religion protestante.
Le capitalisme
Pour Max Weber, le capitalisme moderne, c'est-à-dire le capitalisme d'entreprises fondées sur l'utilisation rationnelle du travail libre (du salariat), est apparu en Occident grâce à un ensemble de préconditions structurelles : en particulier, la présence d'une classe rationnelle que représente la bourgeoisie libre de la ville médiévale a occupé une place essentielle. Toutefois, pour Weber (en cela il s'oppose à Marx), les conditions matérielles objectives dans la naissance du capitalisme ont eu une importance secondaire : ce qui a été décisif fut l'apparition d'une nouvelle morale économique, que Weber nomme « esprit du capitalisme ».
- « Le problème majeur de l'expansion du capitalisme moderne n'est pas celui de l'origine du capital, c'est celui du développement de l'esprit du capitalisme » (in L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme)
Dans ce nouvel ethos économique, la conduite de vie des acteurs est dirigée par le principe selon lequel la finalité de l'existence est le travail dans le cadre d'une profession : le travail devient une fin en soi. Dans l'émergence de cette nouvelle morale économique, les croyances religieuses (le protestantisme en l'occurrence) ont eu, pour Weber, un rôle fondamental. Weber pense ainsi que les principales causes de l'émergence du capitalisme ne sont pas techniques ou économiques, mais principalement éthiques et psychologiques. Si le capitalisme a pu se développer, selon Weber, c'est grâce à l' ascèse du travail dans le monde qui a été au centre du protestantisme calviniste, et plus largement puritain. En effet, dans celui-ci, le travail y devient la plus haute tâche que peut accomplir l'homme pour la gloire de Dieu et, surtout, le fidèle peut trouver dans sa réussite professionelle la confirmation de son statut d'élu de Dieu. C'est dans la sécularisation de cette ascèce, en affinité élective avec l' « esprit du capitalisme », que le capitalisme a trouvé l'impulsion première à son expansion, en lui permettant de vaincre le « monde de forces hostiles » qui s'opposait à lui.
Sources
Cet article a pour base l'article homonyme sur wikipédia au plus tard vers avril 2006 © Copyright auteurs de wikipédia - Source : article Max Weber sur Wikipédia le 20 avril 2006 à 18:17 - Cet article est sous GFDL
- L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme (1904-1905) (traduction française : Gallimard, 2003)
- - Edition anglaise en 1930, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Los Angeles: Roxbury Pub
- - Nouvelle édition anglaise en 1998
- 1917, National Character and the Junkers
- Repris en 1946, In: H. H. Gerth et C. Wright Mills, dir., From Max Weber: Essays in Sociology, New York: Oxford University Press, Ch 15
- Le savant et le politique (1919).
- Économie et Société (posthume 1921)
- Repris en 1978, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, two volumes. Berkeley, CA: University of California Press
- 1922, Aufsätze zur Wissenschafstlehre, Tübingen, Mohr
- Traduction en français en 1965, Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon
- 1947, The Theory of Social and Economic Organization. New York, NY: The Free Press.
- 1949, The Methodology of the Social Sciences. Glencoe: Free Press
- 1975, Marginal utility Theory and the so called law of psychophysics, Social Science Quarterly, 56, 1: 21-36
- 1996, Sociologie des religions (choix de textes et traduction par J-P. Grossein), Gallimard
- 1999, Essays in Economic Sociology. Princeton, NJ: Princeton University Press
Littérature secondaire
Les études portant sur Max Weber en français sont rares et souvent d'assez faible qualité. On retiendra :
- 1946, H. H. Gerth et C. Wright Mills, dir., From Max Weber: Essays in Sociology, New York: Oxford University Press
- 1949, Edward Shils et H. L. Finch, dir., Max Weber on the Methodology of the Social Sciences, Glencoe, Ill.: Free Press
- 1966, Julien Freund, Sociologie de Max Weber, PUF
- 1967, Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologiques, Gallimard. Le chapitre sur Weber a veilli, mais demeure une référence historique
- 1971, Ludwig Lachmann, The Legacy of Max Weber, Berkeley: The Glendessary Press
- 1980, Stephen Kalberg, Max Weber’s Types of Rationality: Cornerstones for the Analysis of Rational Processes in History, American Journal of Sociologie, 85, 3, pp1145-1179
- 1981,
- Anna Elisabetta Galeotti, Tipi del potere e forme del sapere in Max Weber, Quaderni della Fondazione Feltrinelli, 13
- Anna Elisabetta Galeotti, Ordine e ordinarietà: norma giuridica e regole dell’azione sociale in Max Weber”, Sociologia del Diritto, VIII, 1
- 1988, W. Hennis, Max Weber. Essays in Reconstruction. London: Allen & Unwin
- 1990,
- Catherine Colliot-Thélène, 1990, Max Weber et l'histoire, PUF. Une lecture philosophique de Weber. Un ouvrage remarquable
- P. Kivisto et W. H. Swatos Jr., Weber and Interpretive Sociology in America, The Sociological Quarterly, 31(1): 149–164
- 1993, Stephen Kalberg, Salomon's interpretation of Max Weber, International Journal of Politics, Culture, and Society, Volume 6, n°4, juin
- 1998, Andrew Eisenberg, Weberian patrimonialism and imperial Chinese history, Theory and Society, Volume 27, n°1, février, pp83-102
- 1999,
- David Ciepley, Democracy Despite Voter Ignorance: A Weberian Reply to Somin and Friedman, Critical Review, 13(1–2), pp191–227
- Helge Peukert, "Max Weber (1864–1920)", In: Jürgen G. Backhaus, dir., The Elgar Companion To Law and Economics, Edward Elgar Publishing
- 2001, Milan Zafirovski, Max Weber's Analysis of Marginal Utility Theory and Psychology Revisited: Latent Propositions in Economic Sociology and the Sociology of Economics, History of Political Economy - Volume 33, Number 3, Fall 2001, pp. 437-458
- 2002, Maria T. Brouwer, Weber, Schumpeter and Knight on entrepreneurship and economic development, Journal of Evolutionary Economics, Volume 12, n°1-2, mars, pp83-105
- 2003, Reihan Salam, Habermas vs. Weber on Democracy, Critical Review, 15(1–2), pp59–86
- 2004,
- Stephen Kalberg, The Past and Present Influence of World Views. Max Weber on a Neglected Sociological Concept, Journal of Classical Sociology, Vol. 4, No. 2, 139-163
- Fritz Ringer, Max Weber: An Intellectual Biography, Chicago: University of Chicago Press
- Rick Tilman, "Karl Mannheim, Max Weber and the Problem of Social Rationality in Thorstein Veblen", Journal of Economic Issues, Vol. 38
- 2005,
- Jonathan Eastwood, The Role of Ideas in Max Weber’s Theory of Interests, Critical Review, 17(1–2), pp89–100
- Kiichiro Yagi, Karl Knies, Austrians, and Max Weber: a Heidelberg connection?, Journal of Economic Studies, Volume: 32 Issue: 4, pp314 - 330
- 2007, Kiichiro Yagi, Evolutionary Reading of Max Weber's Economic Sociology—A Reappraisal of ‘Marx-Weber Problem’, Evolutionary and Institutional Economics Review, Vol. 3, pp.189-208
Sur Internet
- Ludwig M. Lachmann, The legacy of Max Weber [PDF], 1971
| Accédez d'un seul coup d’œil au portail consacré au libéralisme politique. |
| Accédez d'un seul coup d’œil au portail philosophie et épistémologie du libéralisme. |
| Accédez d'un seul coup d’œil au portail des grands auteurs et penseurs du libéralisme. |