Vous pouvez contribuer simplement à Wikibéral. Pour cela, demandez un compte à adminwiki@liberaux.org. N'hésitez pas !
Principes de politique
| Principes de politique | |
|---|---|
| Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs et particulièrement à la Constitution actuelle de la France | |
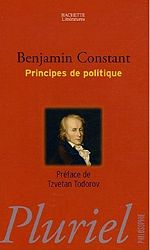
| |
| Auteur : Benjamin Constant | |
| Genre | |
| Œuvre politique | |
| Année de parution | |
| 1806 | |
| Interwiki | |
| Index des essais libéraux | |
| A • B • C • D • E • F • G • H • I •
J • K • L • M • N • O • P • Q • R • S • T • U • V • W • X • Y • Z |
Les Principes de politique sont un ouvrage du philosophe franco-suisse Benjamin Constant. Le titre complet est Principes de politique applicables à tous les gouvernements représentatifs et particulièrement à la Constitution actuelle de la France. Ils ont été rédigés en 1806 et publiés en mai 1815.
Présentation
Dans ses Principes, Constant s'attache à discerner les principes qui doivent guider les institutions et la politique dans une démocratie libérale. A la lumière de l'expérience de la Terreur et des débuts du Premier Empire, il met en exergue les risques du despotisme et défend à l'inverse un pouvoir qui serait limité strictement dans ses fonctions. Ne revenant pas à un individu unique, ce pouvoir ne doit pas plus être donné à une représentation populaire. Constant écrit ainsi : « L'erreur de ceux qui, de bonne foi dans leur amour de la liberté, ont accordé à la souveraineté du peuple un pouvoir sans bornes, vient de la manière dont se sont formées leurs idées en politique. Ils ont vu dans l'histoire un petit nombre d'hommes, ou même un seul, en possession d'un pouvoir immense, qui faisait beaucoup de mal; mais leur courroux s'est dirigé contre les possesseurs du pouvoir, et non contre le pouvoir même. Au lieu de le détruire, ils n'ont songé qu'à le déplacer. »[1]
Benjamin Constant écrit dans le contexte de l'empire napoléonien ; ses Principes étaient à l'origine conçus comme réponse aux Essais de morale et de politique de Matthieu Molé, ouvrage commandé par Napoléon Ier pour justifier son régime. Constant ne cache pas son opposition à certaines pratiques politiques et devra attendre, comme Jean-Baptiste Say avec son Traité d'économie politique, la chute de l'Empire pour publier ses Principes, et encore, dans une version sévèrement remaniée, voire mutilée : c'est la version dite de 1815. Dans son Histoire intellectuelle du libéralisme, Pierre Manent utilise entre autres pour cela le terme de « libéralisme d'opposition » pour caractériser la pensée de Constant[2].
Le texte original des Principes n'a pas été redécouvert avant les années 1960-70, et c'est ce texte original (appelé version de 1806-1810) qui a été réédité en 1997 puis 2006 chez Hachette Pluriel[3] et traduit pour la première fois en anglais en 2003.[4][5]
Livre I : Des idées reçues sur l'étendue de l'autorité sociale
Toute autorité sociale émane de la force ou bien de la volonté générale, i.e. du consentement. Seules anarchie et despotisme sont illégitimes, qui détruisent la garantie et réintroduisent l’état sauvage (pour tous en anarchie, ou pour les seuls maîtres sous le despotisme).
La volonté générale doit exercer sur les individus une autorité illimitée. Même Montesquieu, disant que "la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent" n'a pas vu que "les lois pourraient défendre tant de choses qu'il n'y aurait encore point de liberté". Or, l’on ne cherche jamais plus à étendre le pouvoir que lorsqu’on est en sa possession : l’idée de Rousseau mérite donc d’être réfutée, ne serait-ce que parce que les intérêts sont plus honteux que les opinions.
Rousseau aliène tout l’individu à la communauté, « donc » personne n’a intérêt à nuire aux autres. Sauf que le « souverain », dès qu’il punit, délègue l’usage de la force à ceux qui agissent au nom de tous : certains sont alors plus égaux que les autres. En fait, Rousseau a commis un distinguo de trop, entre droits de la société et du gouvernement. Le second étant l’agent de la première, il peut ainsi l’opprimer en utilisant la même souveraineté illimitée que Rousseau attribue à la société.
L’autorité sociale doit donc être impérativement limitée, et une tyrannie n’est que plus terrible quand les tyrans sont nombreux et se justifient par le peuple. "C'est contre l'arme et non contre le bras qu'il faut sévir. Il y a des masses trop pesantes pour la main des hommes."
Hobbes, lui, donne directement à l’autorité sociale une souveraineté absolue. Sauf que l’introduction du mot « absolu » procède d’un non sequitur. Oui, le souverain a le droit de punir, mais non, il ne peut pas tout punir.
De même, Matthieu Molé a tout repris de Hobbes en y passant un vernis de Rousseau. Son erreur tient à la fois de la souveraineté absolue hobbésienne que du délire rousseauiste. Pour Molé, l’autorité, l’Empereur, ne peut par essence être arbitraire, parce que "Ce n’était plus un homme, c’était un peuple". Quelle garantie !
Face à l’autorité sociale illimitée qu’il avait justifiée, Rousseau a tenté de se rattraper en déclarant que la souveraineté ne pouvait être ni aliénée, ni déléguée, ni représentée : donc qu’elle ne pouvait pas être exercée. La seule façon de ne pas justifier le despotisme était de rendre la théorie inapplicable. Mais certains, se croyant plus brillants que R, y ont vu une incohérence et sont passés outre cette correction, avec les résultats que l’on sait. Les erreurs de Rousseau sont devenues "le prétexte banal de tous les attentats politiques".
Livre II : Des principes à substituer aux idées reçues sur l'étendue de l'autorité sociale
Rousseau a raison en disant que la volonté générale est nécessaire pour légitimer l’autorité, et tort quand il dit que cette condition suffit. La légitimité du pouvoir découle aussi de son objet : "Lorsque cette autorité s'étend sur des objets hors de sa sphère, elle devient illégitime".
Les décisions collectives se forment en moyennant les opinions… Or, mâtiner une vérité, c’est la dénaturer. Par ailleurs, si le droit du plus nombreux est injuste, celui du moins nombreux l’est encore plus (il lèse plus de gens). Contre les erreurs de la majorité, il faut donc limiter le domaine dans lequel elle peut s’imposer (comme des associés qui mettent en commun une part de leur fortune, le reste demeurant privé). L’autorité n’a pas à se prononcer là où des intérêts coexistent sans se confondre. Enfin, les droits de la minorité doivent être défendus, car "Accorder à la majorité une autorité illimitée, c'est offrir au peuple en masse l'holocauste du peuple en détail".
Sans limites à son action, l’organisation de l’État importe peu. "Ce qui m'importe, ce n'est pas que mes droits personnels ne puissent être violés par tel pouvoir sans l'approbation de tel autre ; mais que cette violation soit interdite à tous les pouvoirs." La division des pouvoirs rapproche l’intérêt des gouvernants de celui des gouvernés, quand l’État est limité, chacun subissant le joug de la loi et du gouvernement. Mais quand la loi est sans limites, cette division mène à l’irresponsabilité : autant alors faire de telle sorte que le législateur soit confronté aux problèmes de l’exécution de ses lois.
Mais peut-on limiter l’État ? Qui gardera le gardien ? La division des pouvoirs, ou plutôt les checks and balances ? Mais "Comment borner le pouvoir autrement qu’avec le pouvoir ?" Par l’opinion publique, répond Constant, et par l'esprit civique. "S'il est reconnu que l'autorité sociale n'est pas sans bornes, [...] nul, dans aucun temps, n'osera réclamer une telle puissance."
Quelles limites, alors ? Pour exister convenablement, une société doit pouvoir résister aux agressions et châtier les crimes et les délits, et donc pouvoir financer ces deux activités. Parmi les crimes et délits, certains nuisent par leur nature même, et la société a le droit absolu de les punir, et les autres sont des violations d’engagements, sur lesquels la société n’a qu’une juridiction relative. L’État ne peut pas faire moins, mais il peut s’arrêter là.
Enfin, les droits des individus sont donc "tout ce qui reste indépendant de l’autorité sociale".
Des droits, certes ; mais quid de Bentham et de l’utilitarisme ? Certes, en définissant convenablement ce qui est utile (terme vague), on recoupe les conséquences du jusnaturalisme, et l’on trouve que ce qui n’est pas juste ne peut pas être utile. Mais si l’on ne se réclame que de l’utilité, on ne se réclame plus du droit naturel et de la justice. Les mots restent, tandis que leur explication s’oublie. Le principe d’utilité, comme tout principe vague, peut être interprété de nombreuses manières. Pire encore, se réclamer d’utilité et non de droit, c’est éveiller l’espoir du profit, et non le sentiment du devoir : "Vous détruisez l'utilité par cela seul que vous la placez au premier rang. Ce n'est que lorsque la règle est démontrée, qu'il est bon de faire ressortir l'utilité qu'elle peut avoir.". Le droit est inflexible ; l’utilité, soumise à une appréciation fluctuante. Un voleur pourra même se dire "gain pour moi est plus qu'équivalent pour moi à perte d'autrui". "Il ne sera donc retenu que par la crainte d'être découvert. Tout motif moral est anéanti par ce système."
Livre III : Des raisonnements et des hypothèses qui motivent l'extension de l'autorité sociale
L’État n’a jamais été contenu dans son extension minimale, en fait comme en théorie. En effet, beaucoup de politiciens sont "dévoré[s] du désir de faire le bien", et que autant de philosophes ne voient "dans l’autorité qu’un moyen plus étendu de bienveillance et de bienfaisance", devant diriger, éclairer et améliorer le peuple. Cette extension n’est pas absolument nécessaire, nous l’avons vu : elle est "motivée [par] l’espérance de l’utilité", qui peut tout justifier.
Pour que l’État soit utile hors de son extension minimale, il faut qu’il soit moins sujet à l’erreur que les gouvernés, que, s’il se trompe, les conséquences en soient moins graves, et que les moyens employés ne fassent pas plus de mal que le bien recherché.
L’État fait-il des erreurs ? Dans toute société civilisée, il existe des gens avisés et influents au sein même du peuple et hors du gouvernement. Dans le cadre d’une élection, le peuple serait assez avisé pour bien choisir des élus au rôle vague et vaste, et ne le serait pas pour se diriger lui-même ? (p. 71) Les fonctions d’un État limité "n'exigent des gouvernants qu'une intelligence et une lumière communes telles qu'en assure l'éducation à la majorité de la classe instruite. Il n'en est pas de même des fonctions innombrables et illimitées que l'autorité s'arroge lorsqu'elle franchit ces limites. Il est à la fois moins nécessaire que ces nouvelles fonctions soient remplies, plus difficiles qu'elles le soient bien, et plus dangereux qu'elles le soient mal.". Par ailleurs et plus généralement, le pouvoir aveugle ; un gouvernant est '""appelé sans cesse à agir, [...] placé plus en évidence, aura moins de temps pour la réflexion, plus d'intérêt à la persistance et, par conséquent, plus de chances d'erreurs". Enfin, les intellectuels s’abusent eux-mêmes : "il faut diriger les opinions des hommes" est plus séduisant que "des hommes doivent diriger…".
Quelles en sont les conséquences ? Les erreurs d’un État l’exposent soit à la persévérance dans l’erreur, soit à l’insécurité juridique et politique. Quand un individu se trompe, il est le seul à se tromper, et la loi ou la réalité vient vite le rappeler à l’ordre. Mais un gouvernement, ses erreurs ont la force de la loi, tout le monde est condamné à y obéir. Hors de son domaine, l’État n’est pas directement exposé aux effets de ses erreurs, et le temps qu’il s’en rende compte, en se dédisant, il ridiculise son autorité. Il nous faut chérir le droit individuel de se tromper.
Quant aux moyens, il est nécessaire de considérer les deux côtés du bilan. "Tant que l'on décrit [l]es avantages, on trouve le but merveilleux et le système inattaquable.". Les moyens peuvent être permanents, c’est-à-dire des lois, ou ponctuels : mesures de police ou coups d’État. D’aucuns prétendent à une troisième voie, une action douce, indirecte sur l’opinion[6]. Hors des déclarations de pure forme, "l’autorité, lorsqu’elle commence par des conseils, finit toujours par des menaces", simplement parce qu’un gouvernement, ça ne sait et ça ne peut que commander et punir. Pour ce qui est des moyens, une république stable, qui se dit libre, est prodigue en lois et en règlementations, tandis qu’une république agitée est plus habituée aux coups d’État, qui en engendrent toujours d’autres. En effet, sans expérience du gouvernement, les hommes qui sont portés au pouvoir croient nécessaires les mesures d’autorité, et crient qu’ils ont sauvé la patrie. "Mais c’est une patrie bientôt perdue qu’une patrie sauvée chaque jour". Les monarchies, enfin, utilisent essentiellement les mesures de police[7].
Livre IV : De la multiplicité des Lois
"La multiplicité des lois flattent dans le législateur deux penchants naturels à l'homme, le besoin d'agir et le plaisir qu'il trouve à se croire nécessaire. Toutes les fois que vous donnez à un homme une vocation spéciale, il fait plutôt plus que moins. Ceux qui sont chargés d'arrêter les vagabonds sur les grandes routes, sont tentés de chercher querelle à tous les voyageurs." "Les gouvernants veulent toujours gouverner ; et lorsque, par la division des pouvoirs, une classe de gouvernants est chargée de faire des lois, elle s'imagine n'en pouvoir trop faire. Les législateurs se partagent l'existence humaine, par droit de conquête, comme les généraux d'Alexandre se partageaient le monde."
Même quand la loi est claire, publique et non rétroactive, elle fausse la morale des individus. Tant que la loi reste dans les bornes précédemment établies, pas de différence entre la morale naturelle et la morale émanant des lois. Mais hors de ce domaine, la loi crée des crimes et des devoirs fictifs. Soit les individus se soumettent, auquel cas c’est l’État qui déciderait du bien et du mal et non la réalité (qui, elle, ne fait pas de prisonniers) ; soit il se rebelle et l’État le punit. "Ce qui préserve du crime la majorité des hommes, c'est le sentiment de n'avoir jamais franchi la ligne de l'innocence. Plus on resserre cette ligne, plus on expose les hommes à la transgresser, quelque légère que soit l'infraction.". Prenant l’habitude de l’illégalité, les hommes se corrompent. "Forcer les hommes à s'abstenir de ce qui n'est pas réprouvé par la morale ou leur imposer des devoirs qui ne leur sont pas commandés par elle, c'est donc non seulement les faire souffrir, mais les dépraver."
Certains disent qu’il vaut mieux obéir aux lois qu’aux hommes. Mais dans mille domaines, il ne faut obéir ni aux hommes ni aux lois. De plus, multiplier les lois implique de multiplier les agents de l’autorité, donc les risques d’arbitraire. Enfin, "toute loi écrite est susceptible d'être éludée. [...] Une loi désobéie en appelle une plus rigoureuse. Cette seconde inexécutée en nécessite une plus sévère encore. Cette progression ne peut s'arrêter. Enfin, fatigué de tant d'efforts inutiles, le législateur ne fait plus des lois précises, [mais] des lois vagues et de la sorte la tyrannie des hommes est en dernière analyse le résultat de la multiplicité des lois.".
La loi corrompt aussi l’État. Une loi naturelle est naturellement appliquée par l’action des victimes, la dénonciation est alors la règle, et un devoir. Mais quand elle n’est plus naturelle, personne n’a intérêt à dénoncer les pseudo-délits qu’elle crée : il faut donc inciter à la délation, récompenser le crime en corrompant les agents de l’autorité. Or, un traitre peut trahir à nouveau, et les agents de l’autorité être corrompus par ceux qu’ils sont censés surveiller.
Les lois peuvent enfin survivre aux tempêtes qui les ont créées, tomber en désuétude, et menacer la sécurité des citoyens. Montaigne précisait que "L’une des principales tyrannies de Tibère fut l’abus qu’il fit des anciennes lois." Le gouvernement qui décide de ne plus appliquer une loi rend certes une liberté, mais s’octroie le droit de juger arbitrairement de toute la législation… et la loi peut de nouveau être appliquée à un moment arbitraire. Constant propose une révision périodique de toutes les lois par le Parlement, ou, dans les autocraties, d’annoncer régulièrement les lois maintenues.
Livre V : Des mesures arbitraires
Dans un régime qui se dit libre, les excès de la loi pèsent sur tous. Dans un régime qui n’a pas cette prétention, c’est l’arbitraire qui pèse successivement sur certains. Mais même peu d’arbitraire peut avoir de grandes conséquences.
L’arbitraire est fondé sur son utilité immédiate : "maintenir l’ordre et prévenir les délits". L’autorité a pour droit, et même pour devoir, de répartir de la maréchaussée ou de dissiper des rassemblements dangereux. Mais pas celui de vexer et punir des innocents de peur qu’ils ne se rendent coupables de quelque chose. Or, quiconque est libre peut commettre un délit. De plus, "plus une mesure de gouvernement est contraire à la liberté et à la raison, plus elle entraine et de désordres et de violences. L'on motive alors sur ces violences et sur ces désordres la nécessité de cette mesure.". Tout cela vient de la confusion entre délit possible et délit commencé. L’autorité peut et doit peser contre des actions, pas contre des individus en tant que tels.
L’innocent est-il à l’abri ? On dit souvent « si vous vous tenez tranquilles, vous ne serez pas inquiétés ». Alors, "rassuré par ce vain sophisme, ce n'est pas contre les oppresseurs qu'on s'élève, c'est aux victimes qu'on cherche des torts. [...] Chacun se tait, chacun baisse la tête dans l'espoir trompeur de désarmer le pouvoir par son silence. On ouvre au despotisme un libre passage, se flattant d'être ménagé. Chacun marche silencieusement et les yeux baissés dans l'étroit sentier qui doit le conduire en sûreté vers la tombe." "Lorsque l'arbitraire est toléré, il se dissémine par degrés entre une telle quantité d'agents que le citoyen le plus inconnu peut rencontrer la puissance dans la main de son ennemi" "Des innocents ont disparu, vous les avez jugés coupables, vous avez préparé la route où vous marchez à votre tour."
"L'arbitraire est au moral, ce que la peste est au physique. Il réduit les citoyens à choisir entre l'oubli de tous les sentiments ou la haine de l'autorité." Pas besoin d’ajouter que l’arbitraire, détruisant ce que Constant nomme « la garantie[8]», détruit les anticipations des hommes, donc leur richesse.
L'arbitraire est une drogue pour l’État. "Les moyens arbitraires une fois admis, les dépositaires de l'autorité les trouvent tellement courts, tellement simples, tellement commodes qu'ils n'en veulent plus employer d'autres. De la sorte, présentés d'abord comme une ressource extrême dans des circonstances infiniment rares, l'arbitraire devient la solution de tous les problèmes et la pratique de chaque jour." "Comme [les gouvernants] n'ont plus aucune règle fixe, ils avancent, ils reculent, ils s'agitent, ils ne savent jamais s'ils en font assez, s'ils n'en font pas trop. La loi serait du repos pour eux."
Livre VI : Des coups d'État
Qu’en est-il des coups d’État ? Si, pour Hegel, « Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion », Constant constate que, recouverts de la patine du temps, les coups d’État historiques sont admirés. Et pourtant, "le gouvernement en s'affranchissant des lois a perdu son caractère légal et son plus grand avantage ; et lorsque les factieux l'attaquent avec des armes pareilles aux siennes, la foule des citoyens peut être partagée, car il lui semble qu'elle n'a le choix qu'entre deux factions." "Deux avantages résultent de cette courageuse persistance dans ce qui est juste et légal. Les gouvernements laissent à leurs ennemis tout l'odieux de l'irrégularité et de la violation des lois les plus saintes et de plus ils conquièrent, par le calme et la sécurité qu'ils témoignent, la confiance de cette masse timide qui resterait [sinon] indécise." "Soyez justes d'abord, dirai-je toujours aux dépositaires de l'autorité ; car si l'existence de votre pouvoir n'est pas compatible avec la justice, l'existence de votre pouvoir ne vaut pas la peine d'être conservée." "Permettre [...] aux dépositaires du pouvoir social de violer les formes, c'est sacrifier le but même que l'on se propose aux moyens que l'on emploie." "Une atteinte portée à la liberté individuelle en appelle d'autres ; et le gouvernement une fois entré dans cette funeste route, finit bientôt par n'être préférable en rien à une faction."
La situation est pire encore quand la constitution est écrite, puisque "un gouvernement qui existe par une constitution cesse d’exister aussitôt que cette constitution cesse d’exister, ce qui est le cas dès qu’elle est violée.". "Que reste-t-il après une constitution violée ? plus de sécurité,plus de confiance. Dans les gouvernants, le sentiment de l'usurpation ; dans les gouvernés, la conviction d'être à la merci d'un pouvoir arbitraire." "Le fantôme d'une constitution qu'on outrage nuit beaucoup plus à la liberté que l'absence totale de tout acte constitutionnel." La constitution peut aussi être violée en douceur, par plébiscites (Constant écrit sous Napoléon). "La sanction du peuple ne peut jamais être qu'une formalité vaine. A côté des actes que l'on soumet à cette sanction prétendue, il y a toujours ou la force du gouvernement existant,provisoire ou définitif, ou [...] la perspective, en cas de refus, de guerres et de dissensions civiles." "Si je voyais une nation consultée dans un pays où l'opinion publique serait étouffée, la liberté de la presse anéantie, l'élection populaire détruite, je croirais voir la tyrannie demandant à ses adversaires une liste pour les reconnaître et pour les frapper à loisir." "Les adresses d'adhésion corrompent le peuple. Elles l'accoutument à se courber devant la puissance ; ce qui est toujours une mauvaise chose, lors même que la puissance a raison."
Comment éviter que le pouvoir ne viole la Constitution ? Une constitution doit garantir les droits naturels de chacun : « ne pas être arrêté arbitrairement, ne pas être puni sans avoir été jugé, n’être jugé qu’en vertu des lois et selon les formes, ne pas être empêché de manifester son opinion, d’exercer son industrie, de disposer de ses facultés d’une manière innocente et paisible ». L’autorité ne doit pas pouvoir y toucher, mais doit pouvoir faire tout ce qui n’y est pas contraire. « Étendre une constitution à tout, c’est faire de tout des dangers pour elle » et multiplier les occasions de la violer. Une constitution concise vaut mieux qu’une constitution vénérée et non amendable, car il deviendrait impossible de l’adapter au besoin sans la violer.
Livre VII : De la liberté de la pensée
Les lois ne doivent punir que les actions extérieures et non les pensées, tout simplement parce qu’elles ne le peuvent pas. Quid, alors, de la manifestation de ces pensées ?
Il peut s’agir soit de paroles, soit d’écrits. Restreindre la liberté de parole ne peut qu’amener une société de défiance mutuelle, tant que ces paroles ne font pas partie d’une action criminelle (typiquement, l’incitation à la violence). Et comme d’habitude, l’État ne peut agir que soit dans les formes, en légiférant, et toute loi peut être esquivée, soit hors des formes, donc par l’arbitraire, dont nous avons vu les effets. Les abus de la liberté, généralement dus à son asservissement précédent, sont doux face aux malheurs de la répression de la liberté. Sous la censure, les esprits indépendants sont aigris contre le gouvernement, leurs idées se diffuseront sous le manteau, par allusions et le goût de l’interdit se répandra. "On ne croit rien de ce qu'affirme une autorité qui ne permet pas qu'on lui réponde. On croit tout ce qui s'affirme contre une autorité qui ne tolère pas l'examen." Par ailleurs, "il n'est pas à craindre que le pouvoir manque jamais d'hommes adroits et habiles qui lui consacrent et leur zèle et leur talent. Les partisans de l'autorité ne demandent pas mieux que de se donner le mérite du courage et de représenter l'apologie des gouvernements comme difficile et hasardeuse." Dans un pays où la faction régnante s’est emparée de la presse, cette dernière publie comme si quelqu’un pouvait répondre… Et le public prend cette parodie de liberté pour la liberté elle-même. Toutes les garanties civiles, politiques, judiciaires, sont vaines sans la liberté de presse qui permet de rendre les choses publiques.
Dans les monarchies, la liberté de la presse remplace plus ou moins les libertés politiques, en informant le peuple de ce que fait l’État, et inversement. Quand la presse n’est pas libre, l’opinion publique ne s’y renouvelle pas, le peuple tombe en léthargie, et l’État dépérit. "Le plus grand service que l'autorité puisse rendre aux lumières, c'est de ne pas s'en occuper." L’esprit public, le sentiment qu’il y a quelque chose à perdre, voilà le meilleur garant de l’État : Constant cite alors Bentham qui écrivait "Les chefs des peuples ignorants ont toujours fini pas être les victimes de leur politique étroite et pusillanime. Ces nations vieillies dans l'enfance sous des tuteurs qui prolongent leur imbécilité pour les gouverner plus aisément, ont toujours offert au premier agresseur une proie facile.".
"Ce qui avilit les hommes, ce n'est point de ne pas avoir une faculté, mais de l'abdiquer. [...] Il y a deux sortes de servitude, l'une qui précède la liberté, l'autre qui la remplace. La première est un état désirable si vous la comparez à la seconde." Là où la liberté de presse s’éteint, la classe éclairée continue sur sa lancée, puis disparaît ; la génération suivante ne voit dans les activités intellectuelles qu’inconvénients, et s’en détache. Et, progressivement, la littérature, les arts, la science s’en ressentiront. L’esprit de commerce sera le prochain à disparaitre, les gens ne prépareront plus l’avenir. Ne restera plus que l’intérêt qui pousse à mendier et à piller, notamment par des voies politiques. Même les succès militaires s’en ressentiront. Quand le gouvernement tente de ranimer l’esprit public, son mouvement est factice, le malade a besoin de doses croissantes, "tout marche, mais par le commandement et la menace. Tout est plus cher, parce que les hommes se font payer pour descendre au rang de simples machines."
Que feront les hommes de talent, sous le despotisme ? Les uns se réfugieront dans l’accumulation aveugle et décadente, les autres, dans l’opposition violente. Avec la liberté d’opinion, les premiers auraient été plus vertueux, les autres plus paisibles. Pourquoi les punir ? La faute en incombe à l’État.
Livre VIII : De la liberté religieuse
"Plus on aime la liberté, plus on chérit les idées morales, plus l'élévation, le courage, l'indépendance sont un besoin,plus il est nécessaire, pour se reposer des hommes, de se réfugier dans la croyance d'un Dieu." La religion est, par essence, la fidèle compagne de l’infortuné. C’est aussi la plus naturelle de nos émotions. Comme toutes les passions nobles, elle a quelque chose de mystérieux, car la raison commune ne peut les expliquer de manière satisfaisante. "Je ne veux point dire que l'absence du sentiment religieux prouve dans tout individu l'absence de morale. [...] Je n'aurais pas mauvaise opinion d'un homme éclairé, si on me le présentait comme étranger au sentiment religieux. Mais un peuple incapable de ce sentiment me paraîtrait privé d'une faculté précieuse et déshérité par la nature." Pourquoi les intellectuels ont-ils attaqué la religion ? Dans les mains de l’autorité, la religion n’est que le prolongement de l’État dans la sphère la plus intime. "L'intolérance, en plaçant la force du côté de la foi, a placé le courage à côté du doute." Quant aux athées, laissez-les en paix : "ils jetteront bientôt un triste regard sur un monde qu’ils ont dépeuplé de dieux. [...] Ils verront l’homme seul sur une terre qui doit l’engloutir."
Rousseau, encore lui, a créé l’idée d’une religion d’État, face à laquelle tout incroyant est déclaré asocial et peut être banni. C'est encore plus dangereux que la reconnaissance par l’État d’un nombre (forcément) limité de cultes, qui amène à être injuste envers les autres cultes, et à autoriser l’erreur à bénéficier de la puissance publique.
La multiplication des sectes, des cultes, c’est la vie même du sentiment religieux. Elle l’empêche de dégénérer en ritualisme mécanique, tout en améliorant le niveau moral moyen, chaque secte se voulant plus morale que sa "maison-mère", obligée de suivre. Enfin, quand un seul culte domine, le pouvoir est obligé de l’amadouer, corrompant l’un et l’autre. "Quand un gouvernement prête de la sorte sa hautaine assistance à la religion déchue, il exige d'elle une méconnaissance qui complète son abaissement. [...] Et loin de parler, comme Bossuet, aux grands de ce monde, au nom d'un Dieu qui juge les rois, [ses prêtres] cherchent avec terreur, dans les regards dédaigneux d'un maître, comment ils doivent parler de leur Dieu." Quand il n’y a que quelques cultes différents, se menaçant mutuellement, l’État doit les fliquer. Quand ils sont innombrables, ils se contiennent mutuellement.
Quand l’État veut protéger la religion de la critique, il ne peut agir que sur l’intérêt. Il offre alors une prime à la couardise ou au mensonge, et emprunte une pente très, très glissante. Quand il veut restaurer la religion, cette dernière est défendue par des hommes qui n’y croient pas... ce dont les gens se doutent, ou finissent par comprendre.
« Il faut une religion au (bas-) peuple ». Faux : si elle est nécessaire, elle l’est pour tous, dans la mesure où elle peut fortifier les lois pénales. Par ailleurs, la morale qu'elle génère peut être désirable "non pour réprimer les crimes grossiers, mais pour anoblir toutes les vertus."
Chercher l’utilité de la religion, comme de la beauté de la nature, c’est en flétrir le charme. En France, l’idée que l’on puisse croire pour rien est incongrue, d’où beaucoup de malentendus chez nos intellectuels.
Des athées gouvernant une masse superstitieuse, voilà un idéal d’homme d’État français. Or, le peuple qui voit le politicien impie devient lui aussi impie par imitation, mais pas plus éclairé pour autant.
La tolérance ne peut pas être organisée : lister les cultes actuels, c’est oublier ceux à venir.
L’État doit punir les actions coupables qu’une religion fait commettre, non comme religieuses mais comme coupables. La meilleure arme contre une secte, c’est le libre examen (nécessairement individuel). Et le ministre du culte n’est alors pas plus coupable a priori que le fidèle.
Livre IX : Des garanties judiciaires
Les conditions pour faire du pouvoir judiciaire le gardien des droits des citoyens sont toujours les mêmes. Il faut une parfaite indépendance face à l’autorité, et pour cela, que ses membres soient inamovibles (ni élection, ni nomination temporaire, ni révocation sans jugement). "On s'est élevé fortement contre la vénalité des charges. C'était un abus ; mais cet abus avait un avantage, que l'ordre judiciaire qui a existé durant la Révolution nous a fait souvent regretter, c'était l'indépendance et l'inamovibilité des juges." Quant à l’esprit de corps, il permet de résister aux pressions de l’État, et n’est pas à craindre si il y a des jurés, une possibilité d’appel, une possibilité de procès contre les magistrats qui ont failli, et des lois sensées.
Quand l’État est menacé (ou que les crimes se multiplient), de belles âmes plaident pour "abréger les formes"[9]. Or, les formes sont une sauvegarde. Les supprimer est donc une peine. Ce serait condamner l’accusé qui, par définition, n’a pas encore été prouvé coupable. S’il existe de meilleures formes, plus courtes, qu’on les prenne pour tous les procès, mais qu’il n’existe pas de procès d’exception expéditifs. Les formes sont « les ennemies nées de la tyrannie, populaire ou autre »"".
Même sur les coupables, la société n’a pas une autorité illimitée : il s’agit d’enlever la possibilité de nuire. Toute peine doit être proportionnelle, régie par des lois antérieures et qui ne puisse ni révolter ni corrompre ceux qui en sont témoin : pas de supplices. La peine de mort doit être réservée à très peu de crimes : au moins, le bourreau est seul, et la société n’accomplit pas son horrible tâche à sa place. La prison à vie corrompt geôliers comme détenus, et contient toujours de l’arbitraire. Les travaux forcés sont de l’esclavage, et associer travail et crime est soit cruel, soit indécent. Le mieux est peut-être la colonie pénitentiaire (mais pas le bagne, qui n'est qu'une prison exotique).
Des lois générales ne peuvent s’appliquer à tous les cas particuliers avec une égale justice. Une loi n’est donc jamais parfaitement juste, et c’est pourquoi il faut parfois en empêcher l’exécution. C’est parfois ce que fait le tribunal de cassation, mais il ne cherche l’erreur que dans les formes ; c’est un demi-bien parce qu’il nait d’un abus. Soit le droit de grâce est confié au pouvoir exécutif, auquel cas cette attribution sera vécue comme accidentelle et la grâce pourrait ressembler à une loterie. Soit il est autonome, et la grâce serait accordée selon des règles, selon un jugement, ce qui va contre son utilité première. Il faut pourtant choisir.
Livre X : De l'action de l'autorité sociale sur la propriété
Dans tout pays, il y a deux classes d’habitants : les citoyens, membres de l’association politique, qui votent, et les autres. Être citoyen nécessite d’avoir l’âge (pour disposer d'un minimum d’entendement), de ne pas être étranger (aux intérêts de l’association), et, innovation de Constant, d’être propriétaire.
Pour Constant, la propriété n’est pas antérieure à l’établissement de l’autorité sociale. "Sans l'association, qui lui (la propriété) donne une garantie, elle ne serait que le droit du premier occupant, en d'autres mots, le droit de la force, c'est à dire un droit qui n'en est pas un. [...] La propriété n'est autre chose qu'une convention sociale. Mais de ce que nous la reconnaissons pour telle, il ne s'ensuit pas que nous l'envisagions comme moins sacrée, moins inviolable, moins nécessaire. [...] Sans propriété, l'espèce humaine existerait stationnaire et dans le degré le plus brut et le plus sauvage de son existence."
Mieux vaudrait détruire la propriété que la tolérer comme un abus. "Il faut que la propriété règne, ou qu’elle soit anéantie." Les non-propriétaires, s'ils sont dotés d’un pouvoir politique, s’en serviront pour affaiblir la propriété ou la spolier. Le non-propriétaire comme l’étranger doivent être protégés par les droits élémentaires. Or, les droits politiques ne sont pas une protection, mais une puissance.
Mettre le pouvoir dans la propriété, ce n’est pas mettre de la propriété dans le pouvoir. Attribuer une propriété ou un fort revenu aux gouvernants impose moins le respect : ce que la loi donne, elle peut le reprendre. D'autant que la richesse subite corrompt, rend dépendant et agité.
La propriété peut être foncière, industrielle ou intellectuelle. La propriété foncière, par les soins qu’elle exige, donne le goût des habitudes régulières, de la continuité, de la prudence, du travail, du calme, un sentiment de sécurité et un esprit d’ordre. Le contact avec la réalité forme le jugement et le bon sens du paysan. Le propriétaire terrien est enraciné au pays qu’il habite, alors que l’industriel perd peu à se déplacer. Les landowners sont dispersés, donc difficile à réunir et à soulever. L’industriel, lui, gagne davantage à mettre les bâtons de l’État dans les roues de ses rivaux. La propriété foncière assure donc la stabilité des institutions comme la propriété industrielle garantit l’indépendance individuelle. La propriété intellectuelle, celle des professions libérales, est mal définie. De plus, ces intellectuels sont toujours à la pointe pour ce qui est des idées extrêmes et erronées. Enfin, quiconque est attaché à son pays peut toujours acheter une parcelle de terrain.
Le créancier de l’État n’est intéressé qu’à une chose : sa créance. Dès que ses espérances sont inquiétées, il est le premier à quitter le navire. Dans les grands États, où la dette est inévitable, il importe de réduire ce pouvoir potentiel.
Les droits politiques seront accordés de manière égale à tous ceux dont le terrain permettra l’autonomie financière.
Les propriétaires sont souvent en même temps intellectuels ou industriels ; qui plus est, la propriété circule, renouvelant toujours la classe des propriétaires. Les propriétaires ne seront pas tyranniques car ils n’y ont simplement pas intérêt.
Pour mettre des propriétaires à la tête de l’État, il faut faire que la politique ne puisse pas être source de profit, au moins pour la députation (être député, ce n’est pas très coûteux), sans empêcher par la loi qu’il en soit autrement. Une fonction représentative ne peut être gratuite que si elle est importante et indéfiniment rééligible (elle paie alors par la gloire).
La société a des droits sur la propriété, convention sociale, qu’elle n’a pas sur la liberté, la vie ou les opinions. Mais elle peut lui être néfaste. La loi peut favoriser la concentration ou la conservation sociale de la propriété : elle fait alors de la propriété un privilège, et crée de la jalousie, des troubles, des révolutions. L’institution avait survécu à l’usage (quand la richesse donnait la force nécessaire pour se protéger de la spoliation) qui pouvait en être fait. Les lois agraires et quelques autres, elles, veulent favoriser la dissémination et la circulation de la propriété. Mais c’est forcer ce qui se ferait fait naturellement. Par exemple, pour ce qui est des impôts sur la mort, "les restrictions mises à la libre disposition des propriétés, après la mort des propriétaires, ont l'inconvénient [...] d'inviter à la fraude, de n'exister que pour se voir éludées, de nécessiter l'inquisition, la défiance et la délation. Mais elles ont cet inconvénient de plus que les vices qu'elles entrainent pénètrent jusque dans les familles."
Livre XI : De l'impôt
Nous avons vu qu’il devait exister un État pour assurer des missions que nous appelons aujourd’hui régaliennes, et qu’en conséquence il avait le droit d’exiger un impôt pour financer ces activités. "Les gouvernés ont droit, de leur côté, d'exiger de l'autorité que la somme des impôts n'excède pas ce qui est nécessaire au but qu'elle doit atteindre." Il ne s'agit toutefois pas là d'une arme anti-exécutif, par exemple à des fins pacifistes.
Les gouvernés ont aussi droit de réclamer à ce que l’impôt soit le plus simple possible : typiquement, un impôt explicite, proportionnel à la richesse de chacun, à taux stable et modéré.
Quelques applications, maintenant. L’impôt sur la terre ne convient pas : toute richesse ne provient pas de la terre, et tout impôt ne finit pas par y retomber ; il mène à la disette, et pèse sur les seuls propriétaires fonciers. Il peut être en vigueur, mais il ne peut pas être l’impôt principal. De même, la patente frappe l’industrie de stérilité. Les impôts indirects et les accises ont trois grands inconvénients : ils sont indolores, leur perception pose problème, et ils créent un crime sans victime : la contrebande, "cet apprentissage du crime, cette école du mensonge". Pour le montant, si l’autorité qui vote les impôts est indépendante, ils seront limités ; si elle ne l’est pas, aucun impôt ne sera limité. Pour leur perception, vexatoire et corruptrice, l’organisation peut y remédier en partie. Pour la contrebande, le problème ne se pose guère que pour les taux très élevés, c’est-à-dire pour les interdictions déguisées.
L’impôt devient contraire aux droits des individus quand il permet de manière courante des vexations sur les citoyens, des inquisitions, quand son montant invite à la fraude ou pousse à la ruine, quand l’État force à consommer des produits sujets à droits d’accise ou en interdit la production (gabelle), quand l'impôt est corrupteur[10] ou quand il donne droit à des particuliers d’opprimer le reste de la population[11].
Un impôt doit peser sur un revenu, jamais sur un capital. "Si vous prenez à l'agriculteur un sac de blé qu'il vient de recueillir, il se remet au travail et en produit un autre l'année suivante ; mais si vous lui prenez sa charrue, il ne peut plus produire de blé. [...] L’État qui impose les capitaux prépare donc la ruine des individus. Il leur enlève graduellement leur propriété. Or la garantie de cette propriété étant l'un des devoirs de l'État, il est manifeste que les individus ont le droit de réclamer cette garantie contre un système de contribution dont le résultat serait contraire à ce but.
L’intérêt à long terme de l’État est en fait de ne pas ruiner le contribuable, de le laisser prospérer.
"Tout impôt, de quelque nature qu'il soit, a toujours une influence plus ou moins fâcheuse. Si l'impôt produit quelquefois un bien par son emploi, il produit toujours un mal par sa levée. Il peut être un mal nécessaire. Mais comme tous les maux nécessaires, il fut le rendre le moins grand possible. [...] L'argent du royaume le mieux employé est celui qui demeure entre les mains des particuliers, où il n'est jamais inutile ni oisif." On n’est pas riche parce qu’on paie beaucoup : on paie beaucoup parce qu’on est riche.
L’abus d’impôt tourne la tête des États. "De là des places chimériques, des ambitions effrénées, des projets gigantesques, qu'un gouvernement, qui n'aurait possédé que le nécessaire, n'eût jamais conçus. Ainsi le peuple n'est pas misérable, seulement parce qu'il paie au-delà de ses moyens, mais il est misérable encore par l'usage que son gouvernement fait de ce qu'il paie". L’abus d’impôt nuit au bon sens.
Livre XII : De la juridiction de l'autorité sur l'industrie et sur la population
Observation. Restreindre la liberté d’industrie[12] est injuste, contraire à l’équité, mais cette liberté est vue par beaucoup moins favorablement que la liberté civile. « La liberté du commerce n'est utile que lorsqu'elle est scrupuleusement respectée. Une seule violation répandant l'incertitude dans tout le système, [...] les gouvernements tirent alors parti de leurs fautes mêmes pour justifier leur intervention. »
« La société n'ayant d'autres droits sur les individus que de les empêcher de se nuire mutuellement, elle n'a de juridiction sur l'industrie qu'en supposant celle-ci nuisible. » « La nature de l'industrie est de lutter contre l'industrie rivale, par une concurrence parfaitement libre et par des efforts pour atteindre une supériorité intrinsèque. Tous les moyens d'espèce différente qu'elle tenterait d'employer ne seraient plus de l'industrie mais de l'oppression ou de la fraude. La société aurait le droit et même l'obligation de la réprimer. Mais de ce droit que la société possède, il résulte qu'elle ne possède point celui d'employer contre l'industrie de l'un, en faveur de celle de l'autre, les moyens qu'elle doit également interdire à tous. »
L’État, ici comme ailleurs, peut agir de deux façons : l’interdiction (dont le monopole légal fait partie), et l’incitation.
Constant consacre alors plus de 20 pages à étudier en théorie et dans la réalité historique des privilèges et prohibitions divers, sur un mode qui n'est pas sans rappeler Frédéric Bastiat.
Quid des effets particuliers aux prohibitions ? Comme toute loi injuste, la prohibition commerciale met les individus en guerre contre le gouvernement : en créant des délits factices, elle accoutume certains hommes à violer la loi, et d’autres à vivre du malheur de leurs semblables.
Alors, pourquoi une telle erreur ? Les producteurs poussent eux-mêmes à la règlementation pour limiter la concurrence, or, ces producteurs sont peu, mais tout le monde est consommateur. Les conseillers du prince sont généralement remplis de préjugés mercantilistes ; or, « l'intérêt privé qui est très éclairé, quand il raisonne sur ce qui le regarde et sur ce qu'il doit faire, est un très mauvais guide, lorsqu'on veut généraliser ses raisonnements et en faire la base d'un système d'administration ». Les hommes ne luttent « presque jamais contre les prohibitions en général, mais s’efforcent de les faire tourner à leur profit ». La règlementation est par ailleurs souvent aussi dangereuse à révoquer que fâcheuse à maintenir, sa suppression faisant s'effondrer les calculs de ceux qui comptaient sur son existence.
Une incitation, c’est à première vue « moins pire » qu’une interdiction. Mais quand même, c’est souvent un premier pas vers l’interdiction. Plus encore, les incitations de l’État poussent les capitaux à se déplacer vers des emplois moins productifs, elles troublent les prévisions des individus, plus enclins à s’attirer les grâces de l’autorité qu’à être productifs. Restent l’indemnisation des catastrophes naturelles et l’établissement d’une nouvelle branche d’activité très gourmande en capitaux. Mais même dans ces cas, Constant considère que l’action de l’État est généralement contreproductive.
Constant aboutit en fait à la même conclusion que Jean-Baptiste Say. « Les productions tendent toujours à se mettre au niveau des besoins, sans que l'autorité s'en mêle. » « (L)'effet de l'intervention de l'autorité, dans ce qui concerne l'industrie, quelquefois nécessaire peut-être, n'est jamais positivement avantageux. L'on peut s'y résigner comme à un mal inévitable, mais on doit tendre toujours à circonscrire ce mal, dans les limites les plus resserrées. »
Pour ce qui est de la population, les gouvernements ont fait « des lois coercitives pour forcer l'homme à satisfaire au plus doux penchant de sa nature », pour augmenter la population. Mais lorsque les hommes sont prospères, ont de quoi subsister et faire subsister leurs enfants, leur nombre se multiplie naturellement. L’État n’a aucun rôle à jouer dans la démographie, à moins de vicier les relations sociales.
Livre XIII : De la guerre
La guerre favorise le développement des plus belles facultés humaines : le courage, la loyauté, la fraternité, le dévouement… Pour peu que ce soit la guerre du peuple, non du gouvernement. « Les peuples belliqueux par caractère sont d'ordinaire les peuples libres, parce que les mêmes qualités qui leur inspirent l'amour de la guerre, les remplissent d'amour pour la liberté. Mais les gouvernements qui sont belliqueux malgré les peuples, ne sont jamais que des gouvernements oppresseurs. » Ce n’est toutefois plus valable pour les guerres modernes. « Appliquée à des nations commerçantes, industrieuses, civilisées, placées sur un sol assez étendu pour leurs besoins, avec des relations dont l'interruption serait un désastre, n'ayant [...] aucun accroissement d'aisance à espérer des conquêtes », la guerre sape les libertés, la justice, les garanties, et fait souvent le lit des « États sans limites ».
Les prétextes de guerre sont innombrables. L’indépendance nationale et l’honneur national, d’abord : que dirait-on d’un individu qui croirait son indépendance et son honneur menacés tant que d’autres en posséderaient encore une bribe ? L’influence extérieure, il faudrait d’abord savoir si c’est un avantage ou un malheur. L’arrondissement des frontières, comme c’est bizarre, se fait toujours vers l’extérieur, jamais en cédant du territoire ; et les frontières ne sont jamais assez arrondies. Les intérêts commerciaux, enfin, tous les gens censés savent que le commerce repose sur la bonne intelligence, sur la justice, sur le calme de la paix et non sur les impôts exorbitants nécessaires pour entretenir une armée d’invasion. Et ne parlons même pas de la dilution de la représentation nationale à chaque succès militaire.
Le système militaire, ou plutôt la militarisation de la société qu’imposent guerres de masse et conscription, fait des soldats des robots, mécaniquement subordonnés, des « agents passifs, irréfléchis et dociles », coupés de toutes leurs relations sociales. L’esprit militaire, qui voit le doute et la raison comme une menace, est plus fort que les lois écrites, et il faut le circonscrire.
Comment se prémunir des gouvernements qui poussent à la guerre ? Dire qu’il faut s’en tenir à la défensive, c’est ne rien dire : avant une invasion en règle, de nombreux actes constituent un casus belli. Compter sur le sentiment national, c’est oublier qu’il est impossible à constater. Compter sur le pouvoir législatif, c’est supposer qu’elle sera parfaitement indépendante et qu’elle a elle-même des freins. Seul l’esprit public, qui tient plus à l’organisation de l’autorité qu’à son action, peut quelque chose.
Management de l’armée. L’autorité ne peut pas avoir tous les droits pour recruter ses soldats. Soit on procède par conscription, soit par le volontariat. La conscription a contre elle la spoliation des talents individuels, même si le rachat de la conscription est un peu moins dommageable. Le seul inconvénient du volontariat, c’est qu’il peut être insuffisant, quoique l’inconvénient soit fort exagéré : si la guerre est juste, alors le peuple sait qu’il a quelque chose à perdre, et il s’engagera. Si il pense n’avoir rien à perdre, à qui la faute ? En même temps, si l’on n’accorde pas au gouvernement le droit de conscription dans des cas bien précis, il le prendra de lui-même.
Livre XIV : De l'action de l'autorité sur les lumières
Livre XV : Résultat des recherches précédentes relativement à l'action de l'autorité
Livre XVI : De l'autorité sociale chez les anciens
Livre XVII : Des vrais principes de la liberté
Livre XVIII : Des devoirs des individus envers l'autorité sociale
Notes et références
- ↑ Benjamin Constant, Principes de politique, Edition Guillaumin, 1872, p.9
- ↑ Pierre Manent, Histoire intellectuelle du libéralisme, Hachette Pluriel, 2006, p.181
- ↑ Benjamin Constant, Principes de politique, Hachette Pluriel, janvier 2006, (ISBN 2012793037)
- ↑ Texte disponible en ligne dans la Online Library of Liberty
- ↑
 [pdf]Book review du Journal of Libertarian Studies
[pdf]Book review du Journal of Libertarian Studies
- ↑ cf. aujourd’hui les laudateurs de l’État-Stratège, de Nicolas Tenzer à Bernard Carayon
- ↑ Aujourd'hui, on ne parlerait pas de républiques et de monarchies, mais de démocraties et de dictatures.
- ↑ C'est à dire sensiblement ce que l'on appelle de nos jours la sécurité juridique
- ↑ i.e. court-circuiter la procédure pénale
- ↑ Constant vise ici la loterie nationale qui, n'étant pas obligatoire, n'est pas à strictement parler un impôt, mais qui servait - et sert toujours - à financer l'État.
- ↑ Ici, c'est le fermage de l'Ancien Régime qui est visé
- ↑ On parlerait aujourd'hui de libertés économiques
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (fr)Texte intégral de la version de 1815 sur Librairal
- (fr)Présentation générale de la philosophie de Benjamin Constant
- (fr)Philosophie de Benjamin Constant sur Catallaxia
- (en)Interview with Dennis O’Keeffe about Benjamin Constant’s, Principles of Politics Applicable to All Governments
| Accédez d'un seul coup d’œil au portail philosophie et épistémologie du libéralisme. |
| Accédez d'un seul coup d’œil au portail consacré au libéralisme politique. |